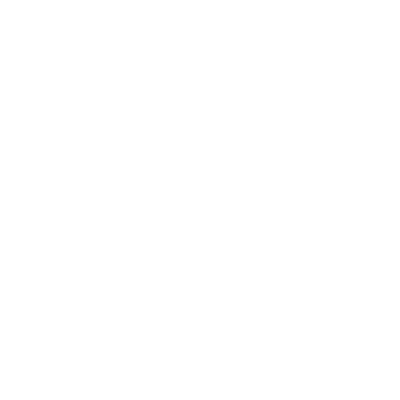Un défi aux clichés
Centrifugeuse à gags, French Kiss affiche sa stratégie de la surenchère : Antonin Peretjatko le dit lui-même (cf. Entretien), l'essentiel ne réside pas dans l'efficacité ou la subtilité de chaque plaisanterie, mais dans la rafale de leur succession. Manifestement allergique au vide, le film enchaîne les pétarades, quitte à ce qu'elles ne soient pas toutes parfaitement dessinées ou abouties et pourvu que beaucoup de registres comiques soient représentés, du naïf à l'égrillard, du langagier au grotesque.
Cette fièvre influe sur la texture même du film, qui n'hésite pas à volontairement débrailler son filmage par le recours à des jump cuts et des mouvements de caméra — souvent des panoramiques — en apparence précipités et cavaliers. Ce dilettantisme formel, bien prémédité, se manifeste aussi dans une photographie sans apprêt et un refus quasi militant de la transition narrative ou visuelle, au profit de coupes franches et rugueuses. French Kiss s'apparente à une pochade composite, un collage soulignant ses jointures, de manière d'autant plus frappante que les deux films précédents de Peretjatko, L'Heure de pointe et Changement de trottoir, présentaient des plans beaucoup plus composés et une stylisation visuelle très homogène (grain élégant du noir et blanc dans le premier, palette de couleurs acidulées dans le second).
Au-delà du seul goût pour la farce, cette précipitation peut aussi être conçue comme le symptôme d'une désorientation plus angoissante. À l'image de ses personnages-pantins n'ayant aucune prise sur leurs gestes (chutes et maladresses) et leurs émotions (l'inhibition de Seb), le film ne semble appréhender que de manière panique un monde ne pouvant plus être déchiffré, a fortiori compris — comme l'attestent les nombreuses références à l'actualité et les commentaires volontiers sarcastiques qu'elles occasionnent dans le dialogue. Il y a là une impuissance bien connue : les dérèglements de l'actualité sont d'autant plus difficiles à saisir que nous sommes surinformés, donc toujours en proie aux paradoxes et aux contradictions des faits, mais surtout à des images préfabriquées et à des stéréotypes. À en croire French Kiss , il est impossible d'échapper au cliché, ce que résume explicitement la séquence des cartes postales (cf. « Analyse de séquence »), tout comme plus tard Kate se rend avec JP dans un solarium qui décline, à travers des posters, des tropiques de pacotille. Deviendrons-nous les touristes de nos propres existences ?
Chaque situation est ici rattrapée par le préjugé (lieux communs antiaméricains ou antifrançais formulés par les personnages, Kate réduisant même Seb à un drapeau tricolore, qui vient masquer le jeune homme à l'écran), l'image d'Epinal désuète (le vendeur de journal gauchiste, comme parachuté d'une autre époque) ou le kitsch mercantile, dont les connotations sexuelles sont explicites : « Kiss » inscrit sur la boîte de maquillage de Kate, nom ambigu du chat Pussy, affiche pour de la lingerie dans laquelle JP découpe une culotte, bouteille de champagne débordante et tour Eiffel du final, qui pourrait conclure un film érotique des années soixante-dix.
Ce parasitage permanent induit un étrange anachronisme : si son intrigue est clairement ancrée dans les années 2000, French Kiss invoque plutôt un imaginaire pop des années 1960-70, insinuant que ses personnages, peuplés de stéréotypes passés et usés, sont voués à toujours être en retard sur leur propre époque, tout comme dans L'Heure de pointe , on utilisait des portables mais dans un univers s'apparentant plutôt aux années 1950.
Proliférant et se télescopant, les clichés anesthésient, rendent illisible le monde. On en vient à ne plus rien percevoir, on ne distingue plus les mots et les choses : lapsus concrétisé des "passeports au chocolat", confusion entre l'église de la Madeleine et la madeleine de Proust, ou encore iris de la caméra qui prend le pas, à la faveur d'un jeu de mot, sur la réalité des fleurs vendues à l'étal (des tulipes en l'occurrence).
French Kiss invoque de nombreux horizons cinématographiques, a priori hétéroclites — sous-genres peu prestigieux (comique troupier comédies sexy de bas étage à la Max Pecas) comédie excentrique américaine (Blake Edwards, le chat Pussy évoquant par ailleurs What's new Pussycat ?), cinéma muet (l'accéléré, l'usage de l'iris), film militant d'avant-garde (les inscriptions à l'écran). Mais aussi la Nouvelle Vague avec singulièrement Éric Rohmer (marivaudage avec une jeune touriste à la lisière du roman-photo) et Jean-Luc Godard : étudiante américaine et jeunes gens sur qui on tire dans une rue (À bout de souffle), insouciance de jeux amoureux en trio (Une Femme est une femme), usage des cartes postales (Les Carabiniers). L'histoire du cinéma n'échappe pas ici à l'étouffante inflation des clichés : les références de répertoire, à force d'être sollicitées par les cinéphiles, deviennent elles-mêmes des cartes postales, se mêlant à la pacotille de série Z.
Face à cette neutralisation, la forme du puzzle tel celui que le personnage de Pierre déverse fébrilement sur une table, est peut-être une issue : une image comme figée, plombée par le cliché, qui ne doit pas tant être regardée que reconstituée. Au risque de mélanger toutes les pièces, French Kiss recolle les morceaux comme il peut.
Hervé Aubron, 2005