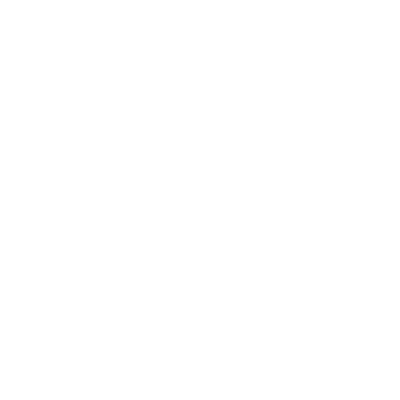Note. Cet article fait partie du dossier Cinq portraits documentaires, dont vous pouvez retrouver l'introduction ici.
Quand sort le documentaire de Barbet Schroeder, Idi Amin Dada règne d’une main de fer sur l’Ouganda depuis trois ans. Comment filmer un dictateur sans se soumettre à sa propagande ? Comment lui faire baisser la garde pour en livrer le portrait le plus juste ? Le réalisateur dira dans un entretien s’être inspiré de la méthode de Jean Rouch, qui, dans le jalon du documentaire Moi, un Noir (1958), a en partie laissé la caméra et la narration off au jeune Nigérien dont il faisait le portrait. À la différence qu’avec un homme de pouvoir, cette passation des moyens du film devait se faire sous les atours de la docilité du cinéaste : « Je lui ai dit : “ Je me mets à votre service ” », explique-t-il dans un complément du dvd ; « “ C’est vous qui devez me dire ce qu’on va montrer de vous. On co-improvise ensemble. ” » Seule règle : « Ne jamais dîner avec lui et ne pas accepter les [prostituées] qu’il voulait m’envoyer. »

Qu'il parade auprès de ses troupes, fasse la morale à ses ministres ou redresse le moral des médecins, Idi Amin Dada se montre soucieux d’exposer clairement sa virilité, exhibant ses jeunes enfants comme autant de preuves de celle-ci ou saluant crânement les crocodiles sur les rives du fleuve. Mais lorsqu’il nage avec deux membres de son entourage, la course tourne à la victoire truquée : d'évidence, les malheureux sous-fifres laissent gagner le tyran de peur d’être sévèrement punis. Partout, le spectre du pouvoir abusif transpire. Le cinéaste joue du pouvoir de la caméra face à une personnalité qu’il sait avide d'omnipotence. L’autoportrait n’en est pas un, c'est évidemment un piège tendu avec les moyens du cinéma, qui font appel au narcissisme malade du dictateur. Pourtant, Barbet Schroeder ajoute une pointe finale qui interdit au spectateur le rejet pur et simple, à peu de frais, de la personne filmée. « Après un siècle de colonisation », demande à la fin le réalisateur en voix off, « n’est-ce pas en partie une image déformée de nous-même que nous renvoie Amin Dada ? » Cette coda qui, à la façon de celle des Maîtres fous de Jean Rouch, tend un miroir au spectateur constitue peut-être l’aspect le plus politique du portrait.

La réception du Général Idi Amin Dada fait partie du film lui-même : quand le dictateur le voit, raconte Schroeder, il prend conscience de sa dimension critique. Il exige alors des coupes et pour les obtenir, va jusqu’à prendre en otage dans un hôtel ougandais une centaine de ressortissants français : le cinéma, qui n’est pas tout-puissant, se soumet. Mais Schroeder sait que le cinéma étend ses pouvoirs jusqu’aux conditions de sa projection. Aussi affiche-t-il dans les salles européennes la liste et le descriptif des différentes coupes : le portrait du dictateur est ainsi prolongé en portrait de censeur. Réintégrées dès qu’Amin Dada perd le pouvoir en 1979, les scènes coupées n’empêchent pas que la version de 52 minutes expurgée ait existé un jour. Le peuple ougandais révolté qui en avait trouvé une copie l’a même brûlée en place publique, le prenant pour un film de propagande.

Le jeu avec les codes de l’hagiographie suscite des questions qui se posent de nouveau à tout documentaire donnant à voir un bourreau. Rithy Panh s'est sans cesse interrogé à ce propos, qu’il soit troublé par la facilité avec laquelle un ancien garde et tortionnaire d’un camp d’extermination khmère reproduit ses gestes d’antan devant sa caméra (S 21, la machine de mort khmère rouge, 2003), ou qu’il mette en doute sa capacité à ébranler le rouleau compresseur idéologique du criminel de guerre emprisonné (Duch, le maître des forges de l’enfer, 2011). Donner la parole à l’ennemi, ménager une place au déploiement de son argumentation et de son récit, c’est prendre le risque que sa parole instrumentalise le cinéma pour persévérer dans sa puissance destructrice. Le portrait documentaire se mue alors en un duel complexe, dont le vainqueur, entre filmeur et filmé, n’est jamais clairement désigné.
SUITE : « IRÈNE »
Autrice : Charlotte Garson, critique de cinéma. Ciclic, 2019.