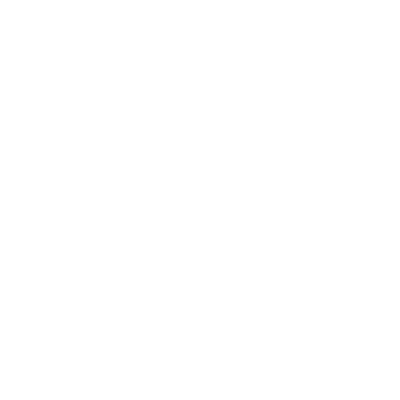Clips et comédie musicale : Grands maîtres et joyeux amateurs
Par essence, le clip et la comédie musicale partagent certains principes. La musique et les images doivent obéir à une certaine coordination (ou un décalage savant). La narration est davantage prise en charge par la tonalité musicale que par le sens des dialogues. Le rythme de la bande sonore effectue un pas de deux avec celui du montage. Cette symbiose entre images et sons n’avait d’ailleurs pas attendu la technique du cinéma sonore pour être explorée. Georges Méliès a ainsi réalisé plusieurs courts-métrages (qu’on peut rétrospectivement qualifier de « proto-clips ») basés sur les mouvements d’un musicien répliqué sept fois (L’homme orchestre, 1900) ou une portée musicale « vivante » où les notes de musiques sont remplacées par des visages chantants (Le mélomane, 1903).
A l’autre bout du spectre, le clip a lui aussi connu ses superproductions dans les années 80, qui s’alimentent à la mythologie du cinéma. Dans Material Girl (réalisé par Mary Lambert en 1984), Madonna reprend explicitement les chorégraphies de Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes (Howard Hawks 1953). Mais la visée est plus sémiologique (voire auto publicitaire) que formelle. Il s’agit avant tout de s’inscrire dans une filiation du star-system plutôt que d’explorer de nouveaux rapports entre images et sons.
Au-delà du pastiche
Le pastiche peut aussi stimuler l’innovation. En 1995, Björk réinterprète It’s oh so quiet, bluette jazzy popularisée par Betty Hutton en 1951, elle-même adaptée d’une ritournelle viennoise composée par Harry Winter en 1948. Pour une chanson déjà issue de plusieurs reprises, le clip réalisé par Spike Jonze, ne peut prendre que les atours d’un somptueux remix visuel, tourné dans une rue archétypale de Los Angeles, avec références transparentes au Magicien d’Oz (les figurants déguisés), Chantons sous la pluie (les chorégraphies de rue et le saut périlleux arrière de Donald O’Connor), Les Parapluies de Cherbourg (le décor du garage et la danse des parapluies), tout cela dans les palettes pastel et pimpantes de Vincente Minnelli. Les effets spéciaux, discrets mais indéniables (à l’image du dernier travelling arrière qui s’élève dans les airs) s’amusent avec les codes et artifices d’un univers déjà artificiel. Mais reconduit aussi le tournage en décor naturel, cher à Stanley Donen et Jacques Demy, insufflant un souffle de vie et d’imprévu dans un monde qui n’est pas entièrement sous cloche.
La comédie musicale n’est pas synonyme d’enfermement dans le studio de cinéma. Que l’on pense au glorieux exemple des Demoiselles de Rochefort (Jacques Demy 1967) où c’est la ville toute entière qui devient studio, avec façades repeintes accordées aux costumes et chorégraphies ajustées à la géométrie de l’urbanisme. Tentons un hardi parallèle avec le clip d’Orelsan, Basique, réalisé par Greg & Lio (Grégory Ohrel et Lionel Hirlé) en 2017. Qu’est-ce qui pourrait, même inconsciemment, rapprocher le rappeur caennais et l’enchanteur nantais ? Tout simplement, ce sens spectaculaire du détournement du paysage portuaire. Tourné sur un pont en construction à Kiev, au-dessus du fleuve Dniepr, ce plan-séquence filmé au drone enregistre une chorégraphie qui tient davantage du défilé (il faut dire que la chanson a aussi des allures de marche militaire), mais témoigne d’une indéniable virtuosité dans la direction de ses 300 figurants.
Difficile de savoir, dans un bon clip, si c’est la musique qui dirige les mouvements des corps ou l’inverse. Le clip de Voodoo in my blood, hymne de Massive Attack, réalisé par Ringan Ledwige en 2016, reste un cas aussi fascinant qu’ambigu. Il croise deux références claires. D’abord, la célèbre scène de Possession (Andrzej Zulawski 1981) où Isabelle Adjani se contorsionne dans un couloir de métro berlinois. Ensuite, l’irruption d’une sphère argentée et menaçante, issue du film d’horreur Phantasm (Don Coscarelli 1979).
Qu’advient-il quand on « musicalise » ces références ? Une étonnante chorégraphie désarticulée où Rosamund Pike révèle toute l’étendue d’une expression corporelle, trouvant une forme de grâce dans la distorsion. Oui, mais tous les mouvements restent ouvertement téléguidés par la sphère métallique et maléfique, d’où aussi l’impression d’une danse de marionnette. La musique fut-elle tribale, et les mouvements secs (Rosamund Pike ne rechigne pas à se jeter contre les murs), c’est bien à une forme de domestication d’un rituel de possession auquel on assiste, évacuant sciemment le trouble de la performance « hors de contrôle » d’Isabelle Adjani.
Inventer ses propres chorégraphies
Émancipé du cinéma, le clip invente ses propres scénographies et ses chefs d’œuvre peuvent prétendre au titre de comédie musicale, par eux-mêmes. Il s’agit simplement d’inventer ses propres règles du jeu. Quand, en 2001, Michel Gondry met en images Come into my world de Kylie Minogue, il accommode la structure couplets-refrains en 4 panoramiques circulaires à 360° autour d’une placette archétypale.
Son animation quotidienne (marchand de fruits et légumes, querelle de stationnement, jeux d’enfants, collage d’affiches…) étant redoublée, à chaque passage de la caméra, par la multiplication des protagonistes, y compris de la chanteuse, qui continue à chanter face caméra, en compagnie de ses clones. Ce processus de reproduction (qui rappelle celui de la comédie Mes doubles, ma femme et moi, Harold Ramis 1996) subjugue parce qu’il parvient à remettre de l’harmonie dans un apparent chaos. Tous les clones se croisent, se frôlent, sans aucun accident, malgré l’impression d’ensemble d’une cacophonie de gestes. Le rythme lancinant de la musique rassure aussi, empêche la joyeuse saturation de l’espace de virer à l’anarchie, quand la rotation permanente de la caméra crée même une douce hypnose.
La précision des mouvements, c’est, plus que par la musique, ce par quoi s’est fait connaître OK Go, un groupe de Chicago finalement plus célèbre pour ses clips que pour ses albums. Parmi les premiers phénomènes de l’ère Youtube, Here it goes again (réalisé par eux-mêmes en 2006) propose une chorégraphie en plan fixe sur des tapis de gymnastique, où les simples calages et décalages des rythmes des appareils crée des mouvements aussi complexes que ceux d’un Busby Berkeley soixante-dix ans plus tôt.
Régulièrement, le groupe a proposé des dispositifs de plus en plus amples, jouant sur une touche loufoque voire absurde, inventant ses propres « machines de Rude Goldberg » (des dispositifs très compliqués pour des actions simples) ou défis de tournage. Le clip End Love en 2010, tourné sur 24 heures dans un parc, avec des mouvements extrêmement lents passés ensuite à vitesse rapide pour apparaître à vitesse normale au cœur d’un monde accéléré. L’heureux bricolage de ces débuts laisse cependant la place à une course aux moyens techniques. En 2014, dans I won’t let you down, les membres du groupe, juchés sur des gyroroues dessinent des figures géométriques en mouvement, qui vues du ciel, évoquent un kaléidoscope géant. Deux ans plus tard, le groupe est carrément dans les étoiles, pour tourner dans les conditions du direct, Upside down and Inside Out à bord d’un avion en vol parabolique. Mettant ainsi à profit une temporaire mise en apesanteur, pour des acrobaties burlesques et explosions de couleur. Du « low tech » des tapis de sport à la technologie spatiale la plus avancée, l’épopée d’OK GO est aussi une traversée ludique des techniques.
Émerveillements
A l’inverse de ces réglages à grande échelle, le clip chorégraphié joue aussi la carte du solo d’artiste. Redécouvrir un acteur, par la grâce d’un renouvellement de ses postures est une expérience délicieuse qui a sans doute frappé plus d’un spectateur devant Weapon of Choice (musique : Fatboy Slim), clip de l’an 2000 de Spike Jonze avec un Christopher Walken félin et aérien, planant pour de vrai dans un hall d’hôtel déserté. Le même Spike Jonze qui signe en 2013 un autre tour de force avec la réalisation « en direct » d’Afterlife, performance conjuguée d’Arcade Fire et de Greta Gerwig, jouant et dansant, à l’unisson de la musique, une scène de rupture en appartement, puis l’étrange traversée d’une forêt enneigée avant de débarquer sur la scène du concert, dans un finale de revue entourée de jeunes ballerines. Délicieux vertige que cet emboitement incongru des espaces, combiné à la fougue de l’actrice (un mélange d’enthousiasme adolescent et d’art du contretemps presque burlesque).
Loin des noms connus, il est aussi d’autres vedettes anonymes. L’hymne blues-rock Lonely Boy de The Black Keys a généré une histoire presque trop belle pour être vraie. La première production du clip, réalisé par Jesse Dylan (le fils de Bob) comptait une quarantaine de figurants. Les premiers montages envoyés par le label ne satisfaisaient ni le groupe, ni le réalisateur, jusqu’à ce qu’il s’intéresse à l’un de ces figurants, Derrick T. Tuggle, vigile pour l’état civil, et occasionnellement acteur et musicien. Filmé en plan fixe, sans apprêt, devant l’entrée d’un motel anonyme, le voilà qui crève l’écran en proposant une danse de sa propre invention, réinterprétation toute personnelle des ondulations de Michael Jackson et de John Travolta dans La fièvre du samedi soir (John Badham 1977) et Pulp Fiction (Quentin Tarantino 1994).
Au diable les lourdeurs de production. Le minimalisme des moyens est transcendé par l’extraversion de la danse. Le danseur, comme le spectateur, sont littéralement traversés par la chanson. De fait, on voit sous nos yeux une nouvelle « chanson de geste » tant le pouvoir immédiat de cette vidéo est de stimuler le mouvement, chez tous ceux qui la regardent.
C’est la gloire des amateurs (à tous les sens du terme) qui éclate à l’écran. Si la comédie musicale est évidemment un art de la précision, avec ses réglages, calages, marquages au sol, il peut être aussi celui d’un surgissement du naturel, plus ou moins provoqué. Un petit joyau récent (février 2020), Savana, Céline, Aya de Chassol, réalisé par lui-même est ainsi une véritable « enfance de l’art » de la comédie musicale.
Un jeu de mains, entre jeunes adolescentes dans une cour d’école, un rythme qui se génère de lui-même entre claquements des paumes et génuflexions accélérées, et voilà la musique qui sourd naturellement de cette captation documentaire. Pas de savante horlogerie, mais un instant saisi au vol, dont on extrait un suc visuel et mélodique. A l’inverse du principe fondateur du clip, c’est la musique qui naît des images, et non l’inverse. Tout en affirmant que le chemin de la création passe par la cour de récréation. Les images, et les musiques, l’alliage secret des deux, la magie qui en découle, tout cela ne devrait rester qu’un jeu.
Auteur : Joachim Lepastier, critique de cinéma. Ciclic, 2020.