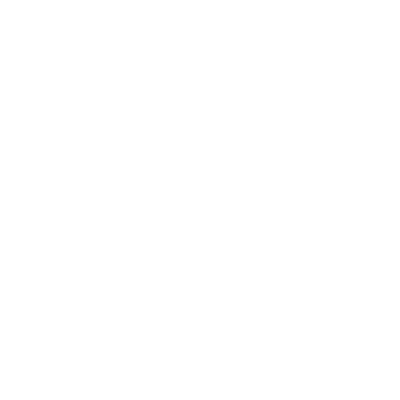Chaplin cinéaste, 20 ans après : entretien avec Francis Bordat
En 1998 paraissait aux éditions du Cerf un des meilleurs ouvrages consacrés à Charlie Chaplin — et un excellent livre sur le cinéma en général : Chaplin cinéaste. Son auteur, Francis Bordat, a bien voulu répondre aux questions d'Upopi.
Signalons au passage qu'en décembre 2017, la revue de cinéma Positif (n° 682) publie un texte de Francis Bordat intitulé « Charlot immigrant : la pensée du mouvement dans le comique chaplinien ».
Vifs remerciements à Francis Bordat et à Christian Viviani.
Entretien proposé par Jean-François Buiré. Ciclic, 2017.
« Ainsi [s'est constitué] un discours dont on a aujourd'hui encore quelque mal à sortir : Chaplin n'aurait pas eu besoin du cinéma pour devenir un « clown de génie » et le cinéma n'aurait pas eu besoin de Chaplin pour devenir le septième art. C'est l'idée que ce livre souhaite contester. » Tel est le programme que vous vous donniez au début de Chaplin, cinéaste. Vingt ans après sa publication, l'opinion générale sur Chaplin vous semble-t-elle avoir évolué ?
Oui, il me semble que mon livre a fait un peu bouger les lignes. Il ne faut pas non plus en exagérer l’originalité. Le mythe de l’« anticinématographicité » de Chaplin avait déjà été dénoncé avant 1998 par beaucoup d’analystes, d’André Bazin à Serge Daney, de Marcel Martin à Joël Magny. Ce qui était nouveau dans mon livre, c’était le caractère systématique de l’approche : la volonté de montrer que d’une part, Chaplin avait mis tous les moyens du cinéma au service de son personnage et de son comique (« hors cinéma, pas de Charlot ! ») et que d’autre part, loin d’avoir renâclé face à l’évolution de l’art et de l’industrie (y compris celle du parlant), il y avait activement participé, d’abord en contribuant de façon décisive à l’élaboration du « classicisme hollywoodien », ensuite en refusant orgueilleusement d’y rester contraint : « Ma technique est le résultat de méditations personnelles, c’est le fruit de ma propre logique et de mon propre point de vue ; elle ne doit rien à ce que font les autres. »
Je crois effectivement que Chaplin est aujourd’hui mieux reconnu comme cinéaste, et non pas seulement comme « clown de génie ».
Les artistes populaires du XXe siècle parvenus à un très haut degré de reconnaissance finissent souvent par se voir opposer une figure d'importance comparable mais considérée, d'une façon ou d'une autre, comme plus « pure », selon des apparences plus ou moins superficielles : Brassens plus anarchiste que Trénet, les Stones plus rock que les Beatles, Franquin plus libertaire qu'Hergé, Godard plus anticonformiste que Truffaut — et Keaton plus « cinéaste » que Chaplin...
Il me semble que dans tous les exemples que vous citez, il y a eu une tentative de démarquage, une volonté de « distinction » (socialement et culturellement surdéterminée), pour promouvoir un art plus « élitiste » (au moins à l’origine, en attendant que lui-même devienne « grand public » — comme c’est arrivé pour Brassens ou les Stones), de l’art plus « populaire » qui lui préexistait. Le « sentimentalisme » de Chaplin, qui modifie très tôt les données initiales de son personnage et change en profondeur la nature de son comique (et qui a renforcé la popularité et l’universalité de Charlot), a agacé certains intellectuels des années vingt (dont les surréalistes), et leur a fait trouver plus « pur » l’art de Keaton (ou celui de Langdon). Le refus du cinéaste d’attirer l’attention sur son style et d’avoir recours aux effets les plus spectaculaires du langage cinématographique a pu également décevoir les amoureux du « septième art ».
La défaveur de Chaplin au profit de Keaton a affecté la cinéphilie française jusque dans les années 1970. Mais je pense qu’aujourd’hui, on peut admirer ces deux génies du cinéma sans devoir établir entre eux une quelconque hiérarchie.
À travers le cinéma de Chaplin, c'est l'ensemble des procédures, des techniques, de la grammaire, des rhétoriques du cinéma que vous abordez. En entreprenant Chaplin cinéaste, aviez-vous aussi l'ambition, le désir conscient d'écrire, grâce à Chaplin et non pas « sur son dos », un livre qui embrasse le cinéma dans toutes ses dimensions ?
Tout à fait. Au delà de l’étude de l’œuvre de Chaplin, et de la défense de son art, ce livre a réellement été pour moi l’occasion de faire un point (une sorte de vaste « révision ») sur ce que je savais et ce que je comprenais du cinéma, y compris dans ses contraintes industrielles et techniques (adolescent, c’est en faisant des films 8 mm que je me suis d’abord passionné pour le cinéma). Un des meilleurs compliments (à mes yeux) qu’on ait fait sur mon livre vient de ceux qui m’ont dit l’avoir utilisé comme un « manuel de cinéma » (pour expliquer à leurs élèves ou à leurs étudiants les effets du cadrage, du montage ou des mouvements d’appareil).
La restauration récente (éditée en vidéo par Lobster) de l'ensemble des premières réalisations de Chaplin — les courts métrages produits par les sociétés Keystone (1914), Essanay (1915) et Mutual (1916-1918) — vous a-t-elle amené à en découvrir encore certains aspects ?
Pour les séries Essanay et Mutual, c’est la beauté photographique des films réédités qui m’a surtout frappé. Mais la réédition des Keystone a été un choc, qui a réellement modifié ma perception de ces premières œuvres (les trente-cinq films tournés en 1914). J’ai eu le sentiment de voir certains films pour la première fois. Dans les années 1990, je n’avais pu travailler (pour cette série Keystone) que sur des copies terriblement altérées et mutilées. Évidemment censurées aussi, car aucuns films n’ont subi davantage de coupures et de remontages que les premiers Charlot — selon des critères innombrables et souvent contradictoires. Mon texte sur « Charlot scabreux » dans Positif doit complètement à la découverte d’images que je n’avais jamais vues et à une qualité de cadrage, de photo, de cadence qui restitue (ou presque) leur impact originel.
Le titre complet du texte que vous venez de citer (paru en juin 2014 dans le n° 640 de la revue Positif) est « Pas pour les enfants : Charlot scabreux »...
Comme des milliers d’enfants du début des années cinquante, j’ai découvert les Charlot au cinéma des écoles (à l’époque le jeudi). Mais Chaplin n’a jamais pensé ses films « pour les enfants ». Ce qui ne veut bien sûr pas dire qu’il faut en priver les enfants. Bien au contraire. Le public des Charlot, c’est le grand public populaire d’hier et d’aujourd’hui, dans tous les pays du monde. C’est un public « adulte », auquel Chaplin, contrairement à Disney, ne parle jamais « comme à des enfants », mais qui inclut le public des enfants, auquel Chaplin parle toujours « comme à des adultes ». La Ruée vers l’or, au moins dans sa version originale de 1925, est un film formidablement drôle, mais très dur aussi, très cynique et à beaucoup d’égards très cru. Ce n’est pas un film « pour les enfants ». Mais pour cette raison même, c’est le meilleur film qu’on puisse montrer à des enfants en âge de le comprendre.
En 1979, dans le texte même (paru dans le n° 297 des Cahiers du cinéma) où il énonce une sorte de bande-annonce de votre livre sur Chaplin (« Il est assez facile (...) de parler du personnage de Charlot, mime et mythe. Il est assez difficile de parler du cinéaste Chaplin. C'est ce qu'il faut commencer à faire »), Serge Daney écrit ceci à propos des Feux de la rampe : « Si Limelight nous touche tant, c'est que Chaplin sait que le cinéma n'est pas le théâtre (...). Si Limelight est un film qui ne perd rien de sa force (au contraire) à la télévision, c'est parce que Calvero nous y regarde comme si, de la nuit où il plonge, il cherchait à reconnaître, en nous mais aussi à travers nous, tous les publics à venir. Nous sommes, devant la boîte-télévision, un de ces publics qu'il regarde mais qu'il ne voit pas. Et cela, il le sait. » Que pensez-vous de cette idée selon laquelle Chaplin aurait eu de l'avance sur toutes les formes de publics, y compris celles qu'il ne pouvait que pressentir ?
Le « C’est ce qu’il faut commencer à faire » de Serge Daney est précisément à l’origine de mes premiers travaux (une thèse de doctorat) sur Chaplin. Pour le reste, le texte de Daney sur Limelight est aussi difficile que profond. Au delà de son sujet central (l’angoisse du clown qui ne comprend ni pourquoi il fait rire, ni pourquoi il ne fait pas/plus rire), la dernière production hollywoodienne de Chaplin pose effectivement la question du public. Chaplin a toujours pensé à son public. C’est pour ce public (le public populaire international) qu’il résiste au parlant pendant les années trente. A l’aube des années cinquante (Limelight date de 1952), il a l’impression de le perdre : il ne le sent plus, il ne le voit plus. Du coup il le rêve et il le sublime, non sans réveiller à cette occasion les « angoisses du clown » qui faisaient déjà le sujet du Cirque en 1928. C’est de cela je pense que Daney veut parler. Mais je crois qu’il faut attendre Un roi à New York en 1957 pour que la question de l’extension du public aux « nouveaux médias » soit réellement posée dans l’œuvre.
Finissons par une autre citation de Chaplin cinéaste : « En simplifiant un peu, je dirais, pour comparer deux films presque exactement contemporains, qu'en voyant Citizen Kane, tous les spectateurs deviennent des critiques de cinéma, alors qu'en voyant Le Dictateur, même les critiques de cinéma redeviennent des spectateurs ordinaires. »
Ce passage renvoie à deux types de films : ceux qui attirent l’attention sur leur forme et ceux au contraire qui cherchent à la faire oublier. Ce qu’il est convenu d’appeler le « classicisme hollywoodien » appartient plutôt à la seconde catégorie (fluidité de la narration, montage invisible), même s’il faut mettre à cette constatation quantité de nuances, notamment dans le domaine du « spectaculaire » qui peut conférer à certaines séquences une dimension « baroque » (comme chez Cecil B. DeMille) ; le cinéma « moderne », dont à certains égards Citizen Kane constitue l’acte de naissance, n’hésite pas à rendre son style (cadrage, montage, mouvements d’appareil) voyant.
Je n’établis aucune hiérarchie esthétique entre Le Dictateur et Citizen Kane, et deux modes d’écriture qui relèvent l’un et l’autre de l’art du cinéma. Je constate simplement que ces films manifestent deux approches totalement différentes de l’expression cinématographique. Avec des effets diamétralement opposés sur le regard de leurs spectateurs.