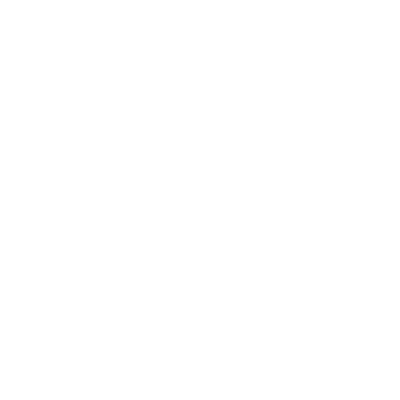Le jeu vidéo : l'art de survivre ensemble ?

Par essence, les jeux vidéo proposent au public la simulation de son combat pour rester vivant. Mais l'idée même de la survie n'a pas cessé d'évoluer au sein du médium : des premières épopées électroniques au jeu vidéo de survie multijoueurs en ligne, en passant par le survival narratif, l'art vidéoludique est passé d'une définition individualiste du terme "survivre" à une acception beaucoup plus large.
Brève mais dense, l'histoire du jeu vidéo est celle d'une réinvention permanente des conditions de la survie. Au point que le médium parait ontologiquement lié à cette notion : il est toujours tentant de le définir comme le simulacre le plus éloquent, et le plus populaire, de la lutte menée par toute entité vivante afin de persister dans son être.
Le jeu vidéo de survie dans sa forme la plus pure

La banalisation de l'épopée sur machine et du lexique de rigueur (tuer, mourir, obtenir des vies) concorde avec l'industrialisation du jeu d'arcade, au tournant des années 70 et 80. Le public est alors invité à maintenir en vie, à travers une série d'épreuves scabreuses, un organisme virtuel : le vaisseau armé de Space Invader, le petit disque glouton de Pac-Man. Au contraire de simulations sportives comme Pong (1972), de tels jeux aménagent un environnement hostile - labyrinthes ou champs de bataille, contextualisés par une narration minimale - au sein duquel s'établit un lien nouveau entre l'utilisateur et son avatar. Le premier prend en charge la "vie" du second : symboliquement, il risque donc bien davantage que la simple élimination, comme le perdant d'un tournoi de tennis ou d'une partie de Monopoly. Mais s'il réussit, il accède au niveau supérieur. Les bornes d'arcade ont ainsi établi un principe appelé à faire autorité sur les consoles de salon, puis dans le jeu en réseau : survivre, c'est faire apparaitre sans cesse de nouvelles images, rendre visibles les pans d'un monde plié en accordéon. Un pacte entre la machine et le joueur est donc tacitement induit par chaque oeuvre, ses clauses sont énoncées par l'intercesseur qu'est l'avatar : "si tu assures ma survie, l'ordinateur t'ouvrira des mondes cachés et prolongera ton bonheur ludique".
Jeux de plates-formes et individualisme

Mais un tel pacte ne dupe personne. Il ne s'agit pas d'un accord collaboratif, supposant de sauvegarder généreusement l'être de l'avatar en tant qu'autre. Car, comme le plaisir du succès (ou l'humiliation de la défaite) dépend de la survie du personnage, le joueur ne voit en ce dernier qu'une extension pixelisée de lui-même. Certains jeux vidéo entérinent leur fusion en adoptant le point de vue "à la première personne". Et le public s'est par conséquent accoutumé à concevoir les jeux vidéo de survie de manière fondamentalement individualiste : l'interaction basique proposée par le "mode solo" suppose de se considérer comme un sujet singulier menacé par un piège numérique. Ainsi, dans le genre dominant du jeu de plates-formes (Super Mario Bros., Sonic, Alex Kidd, Golden Axe…), toute rencontre avec une entité étrangère est potentiellement dangereuse. Celle dont l'innocuité est assurée est désignée "personnage non joueur" (ou "PNJ"). Certes, sauver le PNJ en danger est une option. Mais ce n'est rien de plus : secourir son prochain permet d'accumuler des points, de restaurer sa santé, à terme de renforcer ses propres chances d'atteindre ses objectifs vivant. Négliger autrui n'entrave que rarement la quête personnelle. C'est ce qui distingue les jeux vidéo de survie de leurs modèles cinématographiques : même si la dramaturgie hollywoodienne est traditionnellement réglée sur le pas d'un aventurier solitaire affrontant un système en tant qu'individu charismatique (John Wayne ou Captain Marvel, au choix), il reste possible de reporter son empathie sur des personnages secondaires. Progresser dans un jeu vidéo de survie suppose en revanche de valoriser le destin d'une seule et même entité : soi-même.
Faut-il en conclure que les jeux mainstream ont répandu massivement une conception égoïste de la survie, tout simplement en réduisant la vie elle-même à une quête individualiste ? C'est en tout cas le reproche sous-jacent logé dans les discours visant à diaboliser le médium depuis les années 80, et encore vivaces dans le premier quart du XXIe siècle : l'expérience des mondes virtuels favoriserait le retranchement sur soi, l'identification d'autrui comme menace directe, et donc la propagation d'une violence ordinaire à tous les niveaux de la société. Sans céder à ce type de simplifications obscurantistes, il faut toutefois envisager l'idée que l'industrie, à défaut d'être responsable de la barbarie des masses, ait dans un premier temps promu une approche sommaire et bien peu coopérative de la survie. Dans les opus grand public comme ceux évoqués plus haut, il n'est pas interdit de relever une redondance des incitations aux comportements binaires (manger ou être mangé, tuer ou être tué, selon une éthique du "chacun pour soi"). La plupart des joueurs de la fin du siècle passé n'ont peut-être été confrontés qu'à une seule école survivaliste - la moins altruiste de toutes.
Émergence des logiques collectives dans les jeux vidéo de survie

Mais, depuis leur démocratisation dans les foyers, les jeux vidéo n'ont cessé de prouver leur gain de maturité sur ce point, et c'est d'autant plus vrai concernant les jeux vidéo de survie. D'abord parce que les avancées technologiques ont permis de renouveler l'offre multijoueurs, dominée par la logique des duels "en local" (deux joueurs s'affrontant devant le même écran). L'avènement du MMO (massively multiplayer online) a favorisé l'émergence des logiques collectives, certains titres comme World of Warcraft ou Counter-Strike exigeant la création d'équipes à un niveau avancé. Mais la technologie a aussi encouragé les développeurs les plus audacieux à abattre la muraille entre cinéma et narration vidéoludique. Le plus emblématique demeurant Hideo Kojima, l'une des premières figures "d'auteur" en jeu vidéo. De l'infiltration martiale en deux dimensions, sa saga Metal Gear est passée aux fresques géostratégiques et philosophiques à grand spectacle. Ses foisonnantes galeries de protagonistes sollicitent l'implication affective du public : plus question de n'assurer les arrières que d'un seul personnage. Plus que jamais, les "seconds couteaux" prenaient ainsi part à l'exercice de survie. D'autant qu'en inversant les codes de gameplay classiques, fondés sur l'élimination de l'adversaire, Kojima inventait dès les premiers épisodes de Metal Gear un mode de subsistance basé sur les déplacements furtifs, la fusion avec l'environnement. L'assassinat de l'ennemi devenait au mieux une solution de dernier recours, au pire le signe d'un échec imminent.
Influences cinématographiques et portée politique

Shinji Mikami lui répond à la fin des années 90, en convoquant l'imaginaire du survival filmique avec les Resident Evil. Les épidémies zombies vues chez George Romero (La Nuit des morts-vivants) donnaient alors une ampleur spectaculaire aux mécanismes de survie primitifs datant de Pac-Man - un espace à baliser, des objets à thésauriser, des créatures à tuer ou contourner… Mais elles introduisaient aussi l'empathie et l'entraide comme nouvelles donnes : à l'image des combattants de Romero, le joueur découvre toutes les implications politiques de la survie, et dépasse en permanence l'idée du grand Autre comme émanation du Mal. Car le zombie, comme toujours, ne vient pas de l'extérieur de soi, mais de l'intérieur : c'est à lui-même que héros doit survivre en le croisant. Si le joueur échoue (en étant attaqué et donc zombifié), il se met à faire corps avec le fléau qu'il espérait éradiquer. Le zombie tend donc un miroir au joueur pour mieux interroger son humanité. Les spectres pétulants de Pac-Man étaient loin de matérialiser autant d'ambiguïté.
Sur ces nouvelles bases définies à la toute fin du XXe siècle, le jeu vidéo contemporain n'a cessé d'affiner les modalités de la survie en prenant pleinement acte de sa portée politique. Une certaine dimension collective a repris ses droits. Non seulement parce que le médium est devenu presque intégralement communautaire - comme le prouve l'audience pharaonique de plate-formes telles que Twitch, dédié à la contemplation de parties disputées par d'autres joueurs que soi - mais aussi parce que l'explosion du jeu indépendant a fait fleurir les propositions de gameplay iconoclastes sur le terrain du survival post-apocalyptique (et des jeux vidéo de survie en général). Le genre étant, bien sûr, plus que jamais d'actualité dans la décennie 2010, celle des luttes contre le réchauffement climatique et des alertes lancées par l'intelligentsia scientifique mondiale.
Responsabilisation et reconstruction participative dans le jeu vidéo de survie


Dans la majorité des cas, le salut individuel face à un désastre environnemental passé est troqué contre des enjeux neufs, appelant des comportements moins brutaux et plus rationnels. C'est le cas de The Forest (2014), dont le génie est de lâcher deux rescapés d'un crash d'avion dans une arène ouverte sans mission définie, laissant le joueur inventer son propre mode de survie. De nombreux autres titres responsabilisent l'utilisateur en le laissant seul face à une infinité de choix, tels No Man's Sky ou Last Horizon (2016) qui conjuguent la robinsonnade au futur : l'immensité du cosmos a remplacé l'île déserte de Daniel Defoe, et Vendredi a disparu. L'ennemi, lui aussi, manque à l'appel, et l'effort et donc le jeu vidéo de survie sont donc concentrés tout entier dans la recherche de ressources. Plus que comme une marotte égocentrée, l'exploration spatiale s'avance comme la promesse d'une régénération offerte à toute l'humanité. Ou, mieux, d'une tabula rasa écologique : Surviving Mars invite à coloniser Mars pour la "terraformer", mais en veillant à ne pas répéter les erreurs du capitalisme moderne. Au milieu d'une rentrée 2019 saturée de sorties post-apocalyptiques dans le rayon indépendant, Last Oasis et Stars End profitaient des communautés créées en ligne afin de transformer le survivalisme en expérience de reconstruction participative. Pour réinvestir une zone sinistrée de la Terre grâce à des machines éoliennes, chaque joueur de Last Oasis apporte sa pierre à l'édifice qu'est la nouvelle civilisation, au moyen d'alliances diplomatiques et de trouvailles infrastructurelles. Stars End reprend le même principe collaboratif, en étendant la recherche de ressources à un nouveau système solaire.

Autant d'innovations fondamentalement contre-intuitives pour le consommateur de survivals classiques : les territoires gagnés ne signalent plus la survie d'un seul héros face à ses ennemis, et le triomphe d'un seul joueur, mais le salut d'une communauté entière. Un tel contrepieds ne fait que renforcer la part de challenge, et donc l'attrait de ces oeuvres prônant une forme de responsabilisation du public. Alors qu'il est longtemps passé pour le médium de l'introversion, du solipsisme et du rejet de l'autre, le jeu vidéo a peut-être fini par engendrer l'industrie culturelle la plus propice aux mobilisations de masse autour d'une même question brûlante – celle qui, après tout, lui a donné sa raison d'être originelle : que vaut l'humanité au petit jeu de sa propre survie ?
Auteur : Yal Sadat, 2020