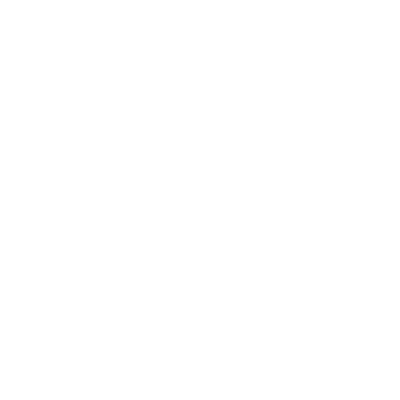L'œil aux aguets
Portrait du cinéaste en chasseur
De la prise de vie à la prise de vue
« La trace reste, le mouvement s’en va ». C’est en ces termes que le physiologiste français Etienne-Jules Marey évoque les motivations qui le poussèrent à concevoir le fusil chronophotographique, développé à partir de 1882. Cherchant à comprendre la machine animale à l’œuvre dans le vol des oiseaux, Marey décide d’adapter un fusil traditionnel en substituant à la chambre de l’arme à feu, une camera obscura. Au fil de ses adaptations, Marey met au point ce qui va devenir l’une des premières, si ce n’est la première, caméra de cinéma de l’Histoire.
À l’origine du cinéma se niche la volonté de déplier le visible, de pénétrer ses caches, de capturer cet insaisissable qui s’incarne sous les traits de la figure animale. Bien plus qu’un simple motif donc, interroger les liens qu’entretiennent le cinéma et cette figure nous invite à revenir à l’essence même du geste cinématographique qui est en définitive celui d’une saisie chasseresse. Le cinéaste serait-il un chasseur comme les autres ? Le cinéaste Chris Marker répondait pour sa part : « La photo, c'est la chasse, c'est l'instinct de chasse sans l'envie de tuer. C'est la chasse des anges… On traque, on vise, on tire et -clac ! au lieu d'un mort, on fait un éternel. » (1) Mais au-delà d’une pulsion de mort retournée comme un gant, que capture-t-on véritablement lorsqu’on filme un animal ?
A l’heure de l’anthropocène
Y réfléchir à l’heure où s’affirme l’idée d’une sixième extinction de masse des espèces vivantes provoquée par l’activité humaine confère à ces questions une autre dimension, teintée d’urgence : quelles conceptions du monde portent en elles les représentations cinématographiques du vivant et des relations que l’humanité (si tant est qu’on puisse l’en extraire) entretient avec lui ? Que trahissent-elles de nous, de notre manière d’habiter, ou de cohabiter vaudrait-il mieux dire, sur cette petite planète avec d’autres vivants ? Revoir aujourd’hui Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle, lauréat de la Palme d’or en 1956, produit un sentiment de malaise face au joyeux dynamitage d’un récif coralien pour s’assurer d’une pêche réussie ou au bain de sang provoqué par le massacre gratuit d’un banc de requins par les hommes de La Calypso. Insensiblement, le regard s’inscrit dans une histoire qu’il importe aussi d’interroger.
Le versant animalier
Un cinéma zoologiste
Pister la présence animale fonde tout d’abord le principe d’un geste de cinéma qui a fini par se constituer en genre à part entière. Relais de la curiosité pour le monde vivant issu d’un XIXe siècle dont l’une des figures totémiques fut sans contexte Charles Darwin et sa théorie de l’évolution, le cinéma animalier est, de fait, l’héritier direct du geste d’Etienne-Jules Marey ou de celui d’Edward Muybridge, mais également des grands voyages d’exploration qui révélèrent à l’Occident la richesse et la diversité des espèces vivantes.
Seul héritier d’un cinéma pensé comme un outil de recherche scientifique à trouver le chemin des écrans et à y fédérer un public, son histoire court en parallèle de l’histoire officielle du cinéma, depuis les films de Jean Painlevé jusqu’à ceux de Jacques Perrin, en passant par le travail de Frédéric Rossif, François Bel ou Gérard Vienne.
Entre le microscope de recherche médical et le télescope d’exploration spatial, le cinéma s’y fait ici révélateur d’invisible. Il nous donne à voir ce que la simple présence de l’homme suffit à faire disparaitre : la présence animale. C’est une forme de battue sans odeur de poudre, où l’animal, succédant à un autre sans discontinuer, paraît dans un surgissement perpétuel, semblant bondir d’une corne d’abondance, du sac de Mary Poppins ou d’un Zootrope pour enfants qui tournerait à l’infini. C’est l’Eden, la joie d’un monde d’avant l’homme, d’une plénitude d’avant la faute. Et c’est aussi tout le paradoxe d’un cinéma qui, fondé sur l’exhibition d’un monde sauvage, s’articule aujourd’hui à un discours sur l’extinction en masse des espèces animales.
Exhibitions
Tendu vers l’objectif d’une saisie cinématographique de la présence animale, le cinéma animalier pose ainsi un certain nombre de questions en termes de représentation. Keith Scholey, coréalisateur de Grizzly déclare sans ambages : « Notre objectif est de pouvoir rivaliser avec un long-métrage normal. On se demande : à quel type de cinéma correspond cet animal ? Avec les chimpanzés, c'était un soap opéra. Pour les félins du Kenya, on était dans un thriller survivaliste avec la compétition, les défis de la savane. » Alliant des moyens techniques exceptionnels avec des voix-off de stars, la dramaturgie de ces films reprend souvent à son compte celle d’un cinéma d’action recherchant le spectaculaire : pulsions sexuelles, combats, dévoration, courses-poursuites déployant une puissance musculaire hors norme. Rabattant le vu sur du déjà-connu, des schémas préconçus ayant démontré leur efficience au box-office sur l’observation naturaliste, l’inspiration zoologiste initiale apparaît in fine comme un faux-semblant.
Plus important encore, que ces films tiennent d’un anthropomorphisme mâtiné d’un discours savant ou d’une démarche plus esthétique cherchant à témoigner de la beauté du monde, l’écran de cinéma semble se substituer à la grille du zoo ou à la paroi de l’aquarium, celle qui fait se confronter deux mondes imperméables l’un à l’autre, l’homme et l’animal, la culture et la nature. Le spectacle ne diffère guère de celui qui présidait il y a plus de deux siècles à l’exhibition de Zarafa la girafe, la présence animale se repliant dans l’exotisme d’un monde-image, fondamentalement étranger au nôtre. Malgré la louable volonté de partager un émerveillement devant les fragiles splendeurs du vivant, rares sont en effet les films permettant d’éprouver et de penser, hors de la simple déclaration d’intention, ce qui se joue dans la rencontre et la coexistence des espèces, humains compris.
A la trace
Sur la piste de l’Homo sapiens
L’anthropologue Louis Liebenberg (2) a développé l’idée, prolongée par le philosophe Baptiste Morizot (3), que l’art du pistage est sans doute à la racine du processus d’hominisation menant à l’apparition de l’Homo Sapiens. Pour déjouer les faiblesses de sa constitution physique, l’homme en chasse aurait développé des capacités de formuler des hypothèses à partir des signes laissés dans la nature par ses proies. Cet effort d’abstraction aurait permis l’émergence de la pensée humaine et de ses capacités d’imagination. Pister, c’est toujours partir de l’observation (un animal est passé par ici) pour écrire un scénario du possible (il est sans doute parti par-là).
Quand le cinéma animalier déploie des moyens techniques ultra-sophistiqués pour traquer l’animal, il gomme pourtant totalement l’attente, l’attention et la réflexion dont il a fallu user pour déjouer la furtivité animale. C’est le cinéaste qui est le chasseur, le spectateur n’étant invité qu’à admirer ses trophées. Est-il dès lors étonnant de constater que c’est plutôt du côté de la fiction que l’on va retrouver figuré cet espace de spéculation qu’est le pistage (4) ?

Film fauve
Éminemment cinématographique, la présence-absence de l’animal sauvage est de fait le moteur de bien des films de fiction. Surprenante et incontrôlable jusqu’à en perdre la tête, la poursuite de l’animal devient course folle dans L’Impossible Monsieur Bébé (Howard Hawks, Etats-Unis, 1938). Associée à un hors-champ pesant d’une sourde menace, elle ouvre sur la traque inquiète de La Féline (Jacques Tourneur, Etats-Unis, 1942). Insaisissable, déjouant les mailles de la fiction, sautant d’un registre à l’autre, elle se mue encore en marche fiévreuse dans Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, Thaïlande, 2004). Lui faisant perdre haleine, l’obligeant à rester sur ses gardes ou le perdant en pleine jungle, à chaque fois c’est le film lui-même qui devient fauve pour le spectateur, déclinant toutes les stratégies de l’esquive pour mieux le surprendre.
Pour le cinéaste, le travail est ici de tenter de reverser au compte du cinéma ce que la présence animale oppose d’abord, impériale, à la volonté de mise en scène : l’indocile, le revêche, le sauvage. A contrario du désir crispé d’apprivoiser, si ce n’est de maitriser, faire de l’inassignable et de l’imprévisible le principe même de son écriture. Accepter de ne pas tracer la voie pour se laisser guider par l’animal, voire même devenir animal soi-même, ainsi que les pisteurs, par un animisme teinté de chamanisme, doivent se transformer eux-mêmes s’ils veulent que la rencontre ait lieu.

Surgissement
Car poursuivre l’animal, c’est se tenir prêt à voir surgir dans un éclair l’invisible. Ce surgissement, qui se joue souvent sur le mode de la déchirure, ouvre de fait une béance dans le réel, fait basculer les apparences. Rencontrer l’animal au cinéma, c’est souvent pour le personnage affronter une altérité radicale qui vient bouleverser l’ordre des choses.
C’est sur ce mode de la trouée que fonctionne par exemple l’apparition du chien dans Le Pain et la rue (Abbas Kiarostami, 1970), des thons dans Stromboli (Roberto Rossellini, 1950) ou de la tortue dans La Tortue rouge (Michaël Dudok de Wit, 2016). L’animal par sa seule présence vient redéfinir, voire ébranler, les certitudes sur lesquelles étaient établies un mode d’être.
Qu’est-ce qui chez lui vient mettre en crise le monde des hommes ? Est-ce la liberté bestiale de l’animal qui viendrait simplement questionner le vernis sociétal, rejouant frontalement la dialectique nature-culture ? Est-ce plutôt d’un retournement de perspective dont il s’agit où le surgissement de l’animal sauvage viendrait souligner la violence propre à la société humaine ? C’est par exemple ce que dessine Equus (Sidney Lumet, 1977) ou bien encore, sur le mode du simple rehaut pictural cette fois, le surgissement inopiné du tigre dans Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979).
Les yeux dans les yeux
Cette trouée s’approfondit encore si l’on avance d’un pas de plus vers l’animal. Le cinéaste met de côté la longue focale et, plongeant son regard dans le regard de la bête, il nous propose soudain l’épreuve d’un face-à-face. Expérience limite sur laquelle s’est largement penchée la philosophie, elle vient également rebattre les cartes de l’expérience cinématographique. Si le champ/contre-champ est l’une des articulations structurantes de la « grammaire » cinématographique - la base de tout dialogue, de tout échange, ping-pong du découpage où chaque question appelle sa réponse, chaque action, sa réaction – le regard animal vient de fait faire éclater la clôture de la fiction.
En mettant de côté les fictions animalières anthropomorphiques, plaquant sur l’animal les schémas classiques de la dramaturgie et réduisant celui-ci à un personnage classique, animé d’intentions et de sentiments directement identifiables par le spectateur (comme le sont par exemple les films de Jean-Jacques Annaud ou de la majeure partie des productions Disney/Pixar), le regard animal est un puit sans fond dans lequel le cinéma fait plonger le spectateur. Que voir dans le regard de l’âne de Robert Bresson (Au hasard Balthazar, 1966), dans celui des vaches d’Emmanuel Gras (Bovines, 2011), des éléphants de Djibril Diop Mambéty (Hyènes, 1992) ou des ours filmés par Timothy Treadwell et repris par Werner Herzog (Grizzly man, 2005) ? Dans le commentaire du film, le cinéaste allemand, catégorique, tranche : « Ce qui me hante, c’est que chez aucun des ours que Treadwell a filmés, je n’ai vu d’affinité, de compréhension, de pitié. Je n’ai vu qu’une accablante indifférence de la nature. Pour moi, il n’y a pas d’univers secret des ours. Ce regard vide n’exprime qu’un vague intérêt pour la nourriture. Mais pour Timothy, cet ours était un ami, un sauveur. » Indifférent ou non, le regard de l’animal n’en reste pas moins un abîme hors d’atteinte, l’Ouvert du sens selon Rainer Maria Rilke (5), sur lequel l’insatiable désir de signification propre à l’homme achoppe. A travers lui, c’est l’homme – « acmé » de l’évolution et roi du monde – qui se trouve regardé et mis à nu par d’autres vivants. La ligne de perspective s’inverse et c’est à nouveau sa propre humanité qui se retrouve au point de fuite. Telle une pointe de réel, le regard animal vient déchirer la toile de l’œuvre comme produit d’une volonté expressive de l’artiste et l’expose à la nudité du monde, qui inéluctablement nous déborde. 
Les cohabitants
Dernier pas sur la piste, le face-à-face entre l’homme et l’animal vient interroger la possibilité d’une coprésence au monde. Impératif environnemental, dont on entrevoit les conséquences, virales entre autres, lorsque cette coprésence vient à être remise en cause, elle est aussi une véritable question de mise en scène. Quelles questions de cinéma pose la cohabitation dans le cadre de l’homme et de l’animal ? En s’appuyant sur Le Cirque (Charles Chaplin, 1928), André Bazin en a tiré une théorie du montage interdit restée célèbre. Pour que le spectateur croit que Charlot, enfermé dans la cage au lion, est réellement en danger, celui-ci doit être filmé dans le même champ que l’animal. La croyance dans la fiction est fragile et cette fragilité se trouve ici redoublé par celle d’un acteur, dont la vie est mise en danger.
C’est sans doute pour cela qu’il est souvent question de mort, possible ou effective, lorsque se croisent à l’image l’homme et l’animal. Et, à bien y regarder, c’est souvent d’une fragilité partagée dont il est question, celle intrinsèque à tous les vivants. Nous reviennent ici Stromboli, Grizzly man ou Bovines mais on peut également penser au Sang des bêtes (Georges Franju, 1949), à Chasseur blanc, cœur noir (Clint Eastwood, 1990), à La Ligne rouge (Terrence Malick, 1998) ou bien encore, sur le mode de la fuite, Les Habitants (Artavazd Pelechian, 1970).
La recherche d’une nécessaire cohabitation entre les espèces que prône l’écologie politique contemporaine prolonge de fait la théorie bazinienne. Pour que le cinéma (le monde) soit possible, la séparation des règnes (dans un plan, l’homme, dans un autre, l’animal) se doit de disparaitre et ceux-ci doivent nécessairement être pensés en coprésence, comme un tout, celui du vivant.
Exploration
Créature mythologique, symbole totémique, figure merveilleuse, l’animal a de tout temps été une figure privilégiée pour l’homme pour penser sa relation au monde. Ecran de projection fantasmatique d’où découle une infinité de questionnements interrogeant nos manières d’être vivant, la présence animale déborde, et de loin, le simple cadre du cinéma animalier. De la même façon qu’il est foncièrement impropre de parler de l’animal comme d’un tout homogène (chaque espèce, chaque individu déplie une manière singulière d’être au monde qu’il faudrait prendre le temps de questionner une par une en termes de représentation), il est absurde de chercher à circonscrire les questions liées à sa représentation à l’écran. Qu’en est-il par exemple des questions de l’animal doudou ou de l’animal monstre, de la question du dressage, de la dialectique domestique-sauvage, de la question du langage ou du silence des bêtes, de celles de la métamorphose, du déguisement ou du masque animal…
Le foisonnement du sens, des sens, possibles : c’est nécessairement sous cet angle qu’il faudra envisager l’approche du programme La Piste animale. Mais découvrir un programme de courts métrages, n’est-ce pas dans tous les cas être aux aguets de traces qu’on retrouverait d’un film à l’autre ? N’est-ce pas pister un sens qui saute sans crier gare la clôture d’œuvres n’ayant pas été conçues pour se côtoyer mais qui, rassemblées, dessinent un territoire au sein duquel des chemins de traverse se lisent pourtant ? N’est-ce pas tenter d’en tracer la carte, d’identifier les anfractuosités, les caches, les culs-de-sac mais aussi les points où la vue soudain se dégage et donne à lire le paysage dans toute son étendue ? Réinventer la place du spectateur comme celui d’un pisteur des traces d’un possible sens, c’est sans doute à cela que nous invite l’exploration de La Piste animale.
Auteur : Bartłomiej Woźnica. Ciclic, 2021.
(1) Commentaire du film Si j’avais quatre dromadaires, 1966.
(2) The Art of tracking : the origin of science, éd. David Philip, 1990.
(3) Sur la piste animale, éd. Actes Sud, 2018.
(4) avec pour contre-exemple notable, La Chasse au lion à l’arc (Jean Rouch, 1965).
(5) Rainer Maria Rilke, Elégies de Duino, éd. Gallimard, 1994.