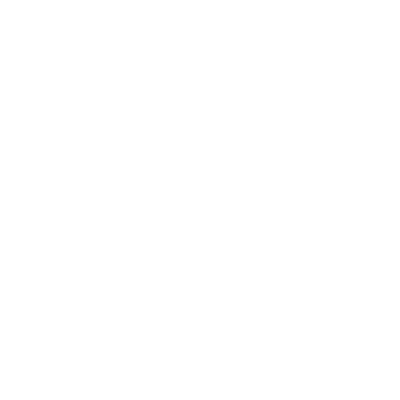L'affiche de film : du fantasme au fétiche

À la fois simple support publicitaire et création graphique valant pour elle-même, outil de promotion et synthèse visuelle de l’esprit d’un film, image fugitive et pièce de collection, l’affiche de cinéma conserve à l’heure du tout-digital son pouvoir de faire naître, ou pas, le désir du spectateur.
De 1986 à 1990, un César de la meilleure affiche était remis, puis cette catégorie a été supprimée. Un César discret et éphémère, apparu très tard, et disparu trop tôt. Mais pas par hasard : symboliquement, sa disparition a coïncidé avec celle des dernières générations de grands affichistes ainsi qu’avec les derniers feux de l’affiche peinte ou dessinée. Ce César donnait à ce support, au métier qu’il recouvrait et aux personnes qui le pratiquaient, une reconnaissance et une légitimité artistiques qui auraient de toute façon peu de sens aujourd’hui. Quel artisan pourrait-on en effet distinguer, quand les affiches sont désormais conçues collectivement, numériquement et anonymement par des agences ? Quelle proposition singulière pourrait-on récompenser, quand la standardisation et l’uniformisation gouvernent le marché ? La forme d’une affiche, depuis toujours, est façonnée autant par des contraintes que par des inspirations.
L’image et le message
« L’art de l’affiche de cinéma est de réduire en une image ce que le metteur en scène a réalisé en 350 000 », disait Stanley Kubrick au moment de la sortie de Full Metal Jacket, dont l’affiche constitue justement un saisissant travail de compression allégorique. Pendant longtemps, et particulièrement dans le cinéma hollywoodien de prestige et d’exploitation, c’est pourtant la pratique de la profusion qui a dominé. Le film se voyait ainsi généreusement déroulé sur l’affiche par l’association de plusieurs images et de textes divers (taglines, pitch, extraits de dialogues ou de critiques), faisant d’elle une sorte de bande-annonce fixe saturée d’informations (ill.1).

ill.1 Quelques exemples d’affiches américaines « agressives » qui délivrent beaucoup d’informations et de promesses aux spectateurs.
Cette approche sensationnaliste et hyperbolique perdure encore aujourd’hui sous différentes formes, mais l’évolution des films eux-mêmes, des canons esthétiques et des outils de communication complémentaires (télévision puis internet) ont depuis plusieurs décennies soulagé les affiches du devoir de tout dire et de tout promettre. Il s’agit moins désormais d’hypertrophier les différents aspects spectaculaires du film que de miser sur une seule image, puissante et évocatrice, dont les concepteurs savent qu’elle sera désormais essentiellement vue sur des médias numériques, sous un format réduit et avec un temps de visibilité très court. La question de la lisibilité de l’image, donc du message, est de plus en plus déterminante.
Car l’affiche n’est pas seulement l’image d’un film, sa représentation synthétisée, elle est aussi à son image : à la fois une œuvre et un produit ; une qualité d’émotion, et une efficacité marchande. Sa fabrication souffre d’un dilemme systématique, qui consiste à concilier la créativité et les contraintes (commerciales, contractuelles, techniques), le souci de séduire et celui d’informer (sur le genre du film, son contenu, ses vedettes…). Ce dilemme a connu, selon les pays et les époques, des solutions extrêmement diverses et contrastées. Qu’ont à voir entre elles les affiches hyper graphiques de Saul Bass, les affiches surréalistes et métaphoriques polonaises des années cinquante et soixante et les affiches jaunes et bleues des comédies françaises contemporaines (ill. 2) ?

ill.2 L’affiche de L’homme au bras d’or par Saul Bass, celle de Sueurs froides par Roman Cieslewicz et celle de À bras ouverts par l‘agence The Alamo.
Que faut-il privilégier : la lisibilité du message ou l’impact esthétique ? L’offre de films est aujourd’hui pléthorique mais les affiches, plutôt que de se singulariser, visent majoritairement une forme de neutralité. Un phénomène de normalisation s’est mis en place, conséquence de choix industriels consensuels face à un marché de plus en plus concurrentiel. Les affiches se contentent de vendre, armées des mêmes codes, des acteurs, un genre, une couleur. Les agences produisent des visuels interchangeables : une seule photo, une police basique plaquée dessus, l’affiche est faite. Mais, à force de précautions, elle est invisible. Ce qui est dommage quand le film n’est pas un produit sans âme mais une œuvre singulière et ambitieuse.
Le cas des affiches rétrospectives et alternatives
Si les affiches de films inédits ont pour vocation principale de créer et de cristalliser du désir autour d’un contenu inconnu, les affiches conçues pour des films du passé - par des distributeurs pour les besoins d’une ressortie ou par des graphistes cinéphiles pour le simple plaisir (pratique très répandue et prisée sur internet) - ont quant à elles pour enjeu de recréer une envie autour d’un contenu familier. Faisant déjà partie de la culture du spectateur, le film classique ne présente plus un univers à figurer, mais un imaginaire partagé qu’il s’agit de revisiter et de rénover. Soumises à moins d’impératifs et de contraintes, les affiches rétrospectives peuvent jouer avec la mémoire du spectateur, réinterpréter des motifs visuels et des émotions déjà éprouvées (cette forme de ludisme et de connivence est poussée au plus loin dans le graphisme minimaliste, qui parvient parfois à synthétiser un film à travers un simple pictogramme). Prenons l’exemple de l’affiche de la réédition du film fantastique Les Innocents de Jack Clayton, conçue par le graphiste américain Brandon Schaefer pour le compte du distributeur Théâtre du Temple en 2015 (ill. 3).

ill.3 L’affiche américaine d’époque des Innocents, celle de sa réédition et celle des Autres, film très influencé par le chef-d’œuvre de Clayton.
L’affiche originale de 1961 a pour caractéristique première de représenter le visage de Deborah Kerr, la vedette du film que les producteurs se devaient de mettre en avant. Les éléments visuels visant à indiquer la nature fantastique du film sont disséminés autour de ce visage sur fond blanc, et sous des formes graphiques volontairement peu précises et incohérentes (un couple représenté en négatif, un autre coloré dans un style enfantin, un manoir qui apporte une touche gothique). Cette imagerie onirico-horrifique nous semble aujourd’hui bien naïve en regard de la nature terrifiante du film, que le texte se charge d’expliciter (« A strange new experience in shock »), mais elle correspond aux normes de l’époque et illustre bien la dimension possiblement hallucinatoire du récit. L’affiche française de la réédition a pour parti pris radical de ne pas représenter l’actrice mais les enfants que le titre désigne, dont la position frontale évoque une pose photographique en même temps qu’une forme d’interpellation du public. Le fond n’est plus blanc mais noir, conformément aux codes actuels du film de genre. Les costumes, la lumière et la teinte légèrement sépia renvoient plus fortement à une tradition du fantastique gothique victorien (donc à la source littéraire du film, l’œuvre d’Henry James), et le remplacement des têtes par des flammes de bougie suggère un univers autrement plus morbide, fantomatique et malaisant. Cette création d’inspiration ésotérique est moins proche de l’affiche d’époque que de celle des Autres d’Alejandro Amenábar (sorti en 2001), très inspiré du film de Jack Clayton. On peut remarquer que le visage de Nicole Kidman, avec son regard angoissé de biais, renvoie quant à lui à celui de Deborah Kerr sur l’affiche originale. Il y a donc entre ces trois propositions tout un jeu d’influences à la fois iconographiques et cinématographiques.
Si recréer le désir autour d’un film de patrimoine peut se limiter à reconnecter le spectateur avec des souvenirs en jouant sur des éléments de nostalgie, qui peuvent être des images devenues emblématiques, ou simplement avec l’affiche d’époque, comme cela a été le cas pour la ressortie en 2020 de Elephant Man de David Lynch par Carlotta films (ill.4), les distributeurs et les graphistes tentent bien souvent une reconfiguration de l’identité du film. Ce n’est plus un effet de nostalgie qui se produit alors, mais un effet de modernité.

ill.4 Un exemple de « reprise » de l’affiche originale.
Cette approche se caractérise non seulement par le refus de recourir à des images iconiques déjà employées, mais aussi par des parti pris de représentation et de composition originaux : représenter autre chose et autrement. Le distributeur Théâtre du Temple a œuvré dans cette voie depuis une dizaine d’années, comme en attestent les affiches conçues pour Blue Velvet de David Lynch, Freaks de Tod Browning ou encore L’Avventura de Michelangelo Antonioni (ill.5).

ill.5 Trois exemples de travail métonymiques jouant sur le gros plan, le flou ou le décadrage.
Blue Velvet est un film dont l’identité est, depuis sa sortie en 1986, façonnée par des images célèbres : le rideau de velours bleu du titre, la haie de roses rouges, l’oreille coupée dans l’herbe, Isabella Rosselini chantant, Dennis Hopper et son masque à oxygène… Cet univers visuel riche a été évincé dans la nouvelle affiche de 2014 au profit d’un seul gros plan, travaillé dans un chromatisme bicolore, rouge et bleu. Ce qui est résumé ici, c’est la dimension morbide et érotique du film. C’est une image d’amour et de mort empreinte d’onirisme, qui tente de restituer une sensualité et une atmosphère plutôt que de mettre en avant un genre ou des acteurs. L’affiche de Freaks, réalisée en 2016, joue quant à elle sur une autre forme de représentation partielle : le flou. Deux des « monstres » du film y sont figurés de profil, donnant l’impression d’une créature bicéphale (il y a par ailleurs dans le film de véritables sœurs siamoises). Le flou, ajouté au titre rouge, suggère une dimension d’horreur : un élément trop choquant pour pouvoir être montré explicitement. Une forme de frontalité s’offre à nous tout en se dérobant. Rendre visible et invisible, montrer et suggérer dans le même temps : c’est toute la question complexe de l’exhibition et de l’exploitation des phénomènes de foire posée par le film, autant que celle du voyeurisme propre au genre horrifique (et au cinéma dans son ensemble), qui sont synthétisées d’une manière sobre. La sobriété est aussi ce qui caractérise l’affiche de L’Avventura, conçue en 2020 : tout un espace vide domine la composition, qui laisse un personnage féminin seul et désemparé en bas à droite. Le décadrage et le regard hors-champ suffisent à rendre quelque chose de la tonalité existentielle du film, qui parle de solitude, d’errance, de confusion des sentiments. Bien que réagencée, cette image extraite du film en reproduit chimiquement les qualités plastiques et la modernité, qui sont légendaires. Par l’épure, une équivalence thématique et plastique entre le film et son affiche est ici opérée. « Design is thinking made visual » (1), disait Saul Bass : ces trois affiches sont des tentatives d’application de ce précepte.
Ce travail de recréation autour de l’identité d’un film classique se développe depuis plusieurs années autour de certains films nouveaux, les graphistes indépendants ayant à leur disposition tous les outils et les supports nécessaires. Toute cette production alternative est passionnante comme symptôme, car elle traduit une frustration effective : celle de voir des films importants affublés d’affiches qui les trahissent, ne font pas corps avec eux ou avec l’émotion qui a été la nôtre, et qui sont vides de toute valeur affective. Les créations alternatives ou rétrospectives procèdent de la même volonté d’illustrer un film en s’émancipant des codes d’hier (désuets) ou d’aujourd’hui (conventionnels). Ces propositions, qui sont autant d’appropriations, représentent un mouvement créatif très vivant et un marché en soi, dont l’industrie ferait bien de s’emparer ou, à tout le moins, de s’inspirer. Car en dépit de sa dissolution dans la communication numérique, l’affiche reste un support unique à haute valeur symbolique, qui a le privilège d’être tout à la fois le film au futur, celui que l’on n’a pas encore vu ni même encore décidé d’aller voir, et le film au passé, figé dans une image qui n’est plus une invitation et une promesse, mais une trace de notre expérience de spectateur ; c’est un fantasme de film, puis, les années passant, un fétiche, un objet de culte que l’on aime posséder et exposer chez soi, un simple bout de papier capable de capturer l’âme du film et de raviver le souvenir de notre émotion.
Auteur : Vincent Dupré. Ciclic, 2021.
(1) « Le design est la pensée rendue visible. »