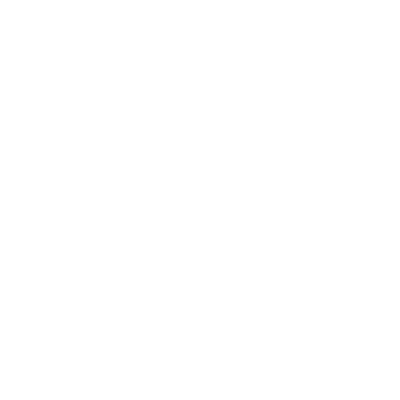Nouveaux personnages féminins de séries : complexes

Depuis vingt ans, les personnages féminins de séries ont gagné en personnalité, en intelligence, en liberté et en diversité physiques et sexuelles.
Bien sûr, on peut parler de la représentation de la femme dans les séries dès I Love Lucy en 1951, mais il faut bien constater que c'est depuis ce qu'on considère comme le « troisième âge d'or » des années 2000 qu'elle a radicalement évolué. En effet, sous l'impulsion des chaînes de télévision américaines câblées, qui ne dépendent plus de la publicité et des diktats du politiquement correct, l'art sériel a considérablement changé, et cela d'autant plus que, comme le dit le producteur et scénariste Tom Fontana, tous les pouvoirs ont été donnés à celui qui écrit. On ne s'étonne donc pas que la représentation des femmes ait elle aussi été bouleversée.

James Gandolfini et Lorraine Bracco (de dos) dans Les Soprano.
Si, depuis le début du XXIe siècle, les personnages féminins ont gagné en épaisseur, dans le même temps les personnages masculins, pour puissants qu'ils soient, ont été montrés dans leurs fragilités. La force d'une Alicia Florrick, dans la série The Good Wife, est contemporaine des névroses qui affectent le parrain de la mafia italo-américaine Tony Soprano. En effet, on prendra pour point de départ la série Les Soprano, créée en 1999 par David Chase, non parce que les portraits de femme y sont les plus bouleversants, mais parce que cet homme, qui tue à mains nues dans le cinquième épisode de la première saison, se morfondait dès le premier épisode dans le cabinet de sa psychanalyste. David Chase, le showrunner, ouvrait ainsi une brèche narrative : les femmes n'étaient plus seules à êtres faillibles et soumises à leur inconscient. Tony Soprano a littéralement des vapeurs, un malaise, lorsque les canards qu'il tentait de domestiquer quittent sa piscine. Syndrome du nid vide, suggère la psy ? Le tabou est en tout cas rompu. On peut être un redoutable mafieux et ne pas arriver à dominer ses angoisses.
Une des raisons du formidable essor qualitatif des séries vient probablement de cette ouverture partagée : la complexité qui est maintenant aussi constitutive de la représentation des femmes enrichit la teneur narrative des séries. Cela a commencé aux États-Unis où, par exemple, on ose montrer une mère de famille qui gère un commerce de cannabis (Weeds de Jenji Kohan, 2005-2012), pour s'étendre en Europe du Nord (la ministre danoise dans Borgen d'Adam Price, 2010-2013), en Angleterre et au reste du monde, d'Israël en Amérique latine.

Sidse Babett Knudsen dans Borgen, une femme au pouvoir.
Certes, si l'on s'en félicite, on ne saurait oublier de mentionner que cette évolution coexiste avec les séries lénifiantes, mièvres, aux personnages féminins réduits à des stéréotypes rétrogrades qui font le succès des productions industrielles. Cela ne doit rien au hasard : quand les studios de Shanghaï embauchent des acteurs pour doubler leurs séries en wolof et inonder le continent africain de ces produits bas de gamme, cela a tout à voir avec le soft power de la puissance chinoise.
Pour revenir à ce qui nous occupe, les séries de qualité, celles que l'on pourrait dire « d'art et essai », il est intéressant de repérer quelques-unes des caractéristiques qui marquent les plus beaux personnages féminins des vingt dernières années. On ne saurait prétendre ici à l'exhaustivité, mais quelques points saillants méritent d'être relevés, à commencer par l'évolution de la représentation physique de ces personnages.

Archie Panjabi dans The Good Wife.
Prenons l'une des plus belles séries de ces dernières années, The Good Wife (2009-2016), conçue et écrite par Robert et Michelle King. Aux côtés de la magnifique Juliana Margulies, perchée sur ses talons de douze centimètres, qui interprète Alicia Florrick, une femme humiliée par un mari politicien infidèle qui reprend son ancien travail d'avocate pour nourrir ses enfants, on trouve son mentor plus âgée, Diane Lockhart, et sa détective maison, Kalinda, interprétées respectivement par Christine Barranski et Archie Panjabi. Alicia et Christine sont certes de splendides femmes dont les robes mettent les jambes en valeur, toutes empreintes du chic impeccable de la bourgeoisie surdiplômée américaine. Mais le trouble surgit ailleurs, dans leurs compétences et leur savoir-faire professionnels ou dans le simple fait que, en toutes circonstances, elles ont un point de vue — nous reviendrons sur ce point. À leurs côtés, Kalinda, une détective glamour, à la bisexualité désinvolte, en jupe et bottes à haut talons qui ne la gênent pas quand elle castagne, ce qu'elle n'hésite pas à faire. Surtout, on notera que le filmage n'érotise pas la baston. Robert et Michelle King ont doté Kalinda d'un double inversé qui parfait la démonstration : le détective auquel elle s'affronte régulièrement est à peu près le seul personnage de toute la série à être mal habillé. Il est affublé de deux enfants en bas âge dont il a la charge, poussette à l'appui. CQFD, si les femmes travaillent, il faut que quelqu'un s'occupe des enfants : l'évolution des personnages féminins de ces vingt dernières années coexiste bien avec celle de leurs hommes.
Des gestes plus amples, un usage de la violence alliés à une féminité traditionnelle, autant d'éléments des années 2010 que les séries « girly » des années 2000 ne se permettaient pas : le girl power est nettement plus sucré. Aujourd'hui, si besoin, les héroïnes savent que leur corps peut être une arme autre que dans la séduction.

À gauche : Cynthia Nixon, Kim Catrall, Kristin Davis et Sarah Jessica Parker dans Sex and the City. À droite : Adam Driver et Lena Dunham dans Girls.
Une série avait permis la transition avec les récits antérieurs, où les femmes étaient soit reléguées au second plan, soit nunuches et sans esprit : Sex and the city de Darren Star (1998-2004). Quatre new-yorkaises sophistiquées y bavardaient sans arrêt de leur sexualité. La rupture a été assez marquante pour qu'un poster de cette série soit affiché dans la chambre du personnage de Shoshanna, au tout premier épisode d'une série phare ultérieure : Girls (2012-2017).
Dix ans ont passé depuis Sex and the City, la nouvelle génération de trentenaires connaît la pornographie gratuite mais surtout bénéficie des acquis de décennies de féminisme, comme l'a démontré Iris Brey dans son livre Sex and the Series (Soap éditions, 2016). La showrunneuse qui écrit, réalise et joue dans Girls, Lena Dunham, n'hésite pas à montrer son corps bien dodu, nu dans des scènes de sexe explicites. La liberté d'une femme peut être aussi d'assumer ses formes, même quand elles ne correspondent pas aux standards de la mode.
Celle d'un scénariste peut être de choisir un personnage de « grosse » sans donner à la juger sur ce point. Il en va ainsi en 2014 pour la policière boudinée dans son uniforme interprétée par Sarah Lancashire dans la série britannique Happy Valley (2014-2015), écrite par Sally Wainwright. Malgré quelques exceptions, choisir une actrice dont le physique ne correspond pas aux canons de la presse magazine reste une véritable transgression.

Sarah Lancashire dans Happy Valley.
Doter les personnages féminins de physiques « imparfaits » n'est pas anecdotique, cela compte dans l'évolution de la représentation des femmes : tout comme ils montrent des héroïnes grosses, les scénaristes peuvent se tourner vers des personnages moins stéréotypés, par exemple issus d'une autre origine sociale, à la sexualité minoritaire, voire d'âge mûr. Une autre série importante a joué de cette diversité : Orange Is the New Black conçue par la créatrice de Weeds, Jenji Kohan, encore une femme, on le notera. Commencée en 2013, cette série montre des Américaines en prison, mais il s'agit de quelques très rares femmes blanches pour une majorité de latinos et de noires, à l'image de ce qui se passe dans le système carcéral des États-Unis. N'insistons pas sur le fait que les popotins sont bien présents et mis en valeur par l'uniforme. Ces femmes sont clairement dépeintes sous l'angle de l'intersectionnalité, ce concept établi par la juriste Kimberlé Crenshaw en 1989 qui met en valeur la possible addition de plusieurs discriminations, corpulence, âge, race, religion, sexualité... Pourtant, rien de théorique dans ce récit qui bénéficie des évolutions narratives déjà évoquées : physiques non standard mais aussi mobilité accrue dans les gestes (laquelle donne lieu à des bastons mémorables), sexualités loquaces et variées, mixité des différentes couches de la société américaine, intérêt pour des héroïnes au corps flétri...

Uzo Aduba et Danielle Brooks (au premier plan), Adrienne C. Moore (au second plan à gauche) dans Orange Is the New Black.
Ces changements vont dans le même sens. On délaisse les stéréotypes de « l'éternel féminin » bien ancrés dans la production industrielle : depuis l'orée du XXIe siècle, les séries partent à la conquête de ce qui peut mieux rendre compte des femmes d'aujourd'hui, la banalité, l'ordinaire — alors même que ces personnages sont justement plus complexes que les clichés sur pattes qui leur préexistaient. Cette banalité leur permet de ne pas être confinée aux extrêmes, alors qu'auparavant les personnages féminins restaient cantonnés à l'image vitrifiée de la mère de famille plus ou moins sanctifiée, de la femme fatale ou de la pute qui finalement ne valent pas mieux que la « girl next door » affligée d'une pensée pré-technique... Elles se révèlent alors contradictoires, brillantes ou abattues, intègres et faillibles, etc. Bref, humaines et non pas glacées, figées dans ce que la doxa attend d'elles.
Une des plus belles conquêtes des scénaristes est celle de l'intelligence : certaines des héroïnes de ces dix dernières années sont éblouissantes d'agilité intellectuelle, leur précision dans l'action dépasse la simple compétence professionnelle, et qu'elles soient flics ou avocates, mère de famille dealeuse ou prisonnière de droit commun, elles ont un point de vue sur ce qui leur arrive. Chacune le défend, avec une autonomie intellectuelle variable. Parfois cela fait des étincelles, comme lorsque Patty Hewes (Glenn Close) développe des stratégies juridiques diaboliques dans Damages de Todd et Glenn Kessler (2007-2012), ou lorsque dans le registre opposé, l'intelligence cultivée de Poussey (Samira Wiley) ou la folie intermittente de Suzanne (Uzo Aduba) apportent un peu de douceur dans le monde carcéral d'Orange.

Glenn Close, à droite, dans Damages.
Physiques plus proches des femmes ordinaires, sexualité explicite, compétences affirmées et point de vue assumé, intelligence, autant de traits inhabituels dans la production industrielle audio-visuelle : depuis vingt ans, les séries nous montrent des personnages féminins plus complexes au même moment où elles dotent leurs héros masculins de certaines caractéristiques — faillibilité, sensibilité — dont les hommes font preuve dans la vie réelle mais peu dans leur représentation. C'est probablement dans cette évolution parallèle (quoique non homothétique) que les séries d'aujourd'hui puisent une partie de leur force. C'est peut-être aussi parce que davantage de femmes les conçoivent et les écrivent, les Virginie Brac, Michelle King (et son mari), Jenji Kohan, Anne Landois, Shonda Rhimes, etc, que le regard se déporte des stéréotypes : Anne Landois me confiait souhaiter ne pas apporter certaines informations de manière traditionnelle et me parlait du travail que cela lui demandait. Comment faire comprendre qu'un personnage de flic est enceinte ? Certainement pas par des nausées. Il suffit de regarder le premier épisode de la cinquième saison de la série française Engrenages (créée en 2005), pour apprécier la façon dont l'invention scénaristique, une fois sortie des sentiers battus, peut nous surprendre.
Autrice : Carole Desbarats, directrice de la communication et de la diffusion des savoirs à l'École Normale Supérieure. Ciclic, 2019.