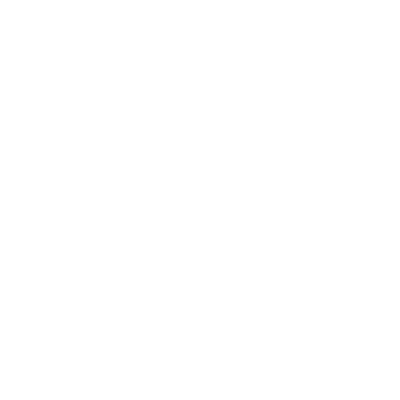Qu'est-ce que le détournement ? Le dictionnaire dit : « Changer la direction de (quelque chose). » Quelque chose allait quelque part, et on l’emmène ailleurs : on détourne un cours d’eau, une conversation. Aussi bien, on détourne une idée : par exemple celle qu’eut un ingénieur physiologiste, Étienne-Jules Marey, de décomposer le mouvement par la photographie pour mieux comprendre le fonctionnement de la machine humaine. Idée géniale, sitôt détournée de son cours scientifique pour rejoindre, avec Thomas Edison puis les frères Lumière, la rive du spectacle populaire : le cinéma était né — d’un détournement.
Aujourd’hui, le mot évoque peut-être en premier lieu un geste politique, de l’ordre de la piraterie (on détourne des images comme on détourne un avion ou des fonds), né dans les prémices de mai 68 et digéré depuis par l’industrie du spectacle (la moindre publicité, le moindre plateau de télé s’en régalent désormais), qu’il avait pourtant vocation à contrarier. Mais à y réfléchir, c’est le cinéma tout entier qui relève du détournement. Détournement des acteurs, des décors, des objets, sitôt qu’ils sont pris dans le courant du montage : accoler deux images, c’est leur donner une direction qu’elles n’auraient pas prise seules. Il faut aller plus loin : c’est au fond le propre de tout art que de faire d'une chose autre chose. D’un paysage, une allégorie ; de quelques pigments, un paysage ; d’un morceau de glaise, un corps ; d’un peu de lumière, un film. Le détournement est l’autre nom de la poésie.
L’histoire de l’art est conduite par le détournement : pas seulement du monde, mais aussi de l’art qui a précédé. Qu’une œuvre cite une autre œuvre, et c’est déjà du détournement. Or le cinéma, peut-être parce qu’il fut vite, sous l’empire d’Hollywood, déployé en une myriade de genres aux codes très identifiables, n’est pas le moins autophage des arts. Quand Jean-Luc Godard tourne À bout de souffle (1960), que fait-il sinon détourner le film noir américain, c’est-à-dire lui donner la direction indue de la modernité ? De même quand Tarantino, plus de trente ans après, cite à la fois Godard et les films noirs que lui-même citait : l’histoire du cinéma, au fond, n’est peut-être rien d’autre que le détournement continuel du tout premier film. Mais détourner les codes, c’est aussi, et peut-être avant tout, leur donner une visibilité renouvelée — détourner un genre, c’est désigner ce qui en fait un genre. Ainsi l’exercice du détournement se révèle-t-il un puissant outil d’analyse, à la fois des films eux-mêmes et de notre condition de spectateur, soudain tiré du sommeil de l’habitude : changer la direction des choses, c’est d’abord soulever le voile d’évidence qui les recouvre et nous les rend un peu trop naturelles.
Ici se loge la part subversive du détournement. Quand Marco Ferreri tourne, en 1973, un western dans le chantier des Halles (Touche pas à la femme blanche), il opère un triple détournement : détournement des codes d’un genre et de l’idéologie qui y a cours, détournement d’un lieu (le « trou » des Halles reconverti en paysage de l’ouest américain), détournement enfin de l’argent de son producteur, dont il désirait se venger. Mais la satire est peut-être d’autant plus efficace qu’elle endosse intégralement les habits du genre qui l’inspire. Ainsi du détournement à la fois monumental et invisible auquel s’est employé, au cœur de l’industrie hollywoodienne, Paul Verhoeven avec Starship Troopers (1997), poussant dans leurs derniers retranchements les codes du film de guerre pour en révéler le substrat fasciste. C’est le même genre de malice qui inspire les détournements de commande. À la fin des années 1980, la société Darty a l’idée un peu masochiste de commander à Godard un film au sujet de sa marque avant de se raviser devant la radicale ironie d’un Rapport Darty qui, s’il fut bien évidemment refusé par son commanditaire, n’en a pas moins rejoint l’œuvre godardienne. De même, en commandant trente ans plus tôt un éloge des matières plastiques à Alain Resnais, le groupe Pechiney ne s’attendait-il pas au poème à la fois potache et funèbre qu’est Le Chant du styrène.
Ainsi le cinéma documentaire se prête-t-il tout particulièrement au détournement, au point d’inspirer une catégorie à part entière, le « faux documentaire » (mockumentary), dans lequel l’exercice parodique relève également d'une entreprise de dessillement du spectateur. Produisant du faux sous les atours du vrai, ces films nous rappellent combien la nature analogique du cinéma est trompeuse, en nous rappelant que toute image est, de fait, le détournement d’une réalité : il n’y a au cinéma de réalité que regardée, si bien que le réel y est à la fois partout et nulle part. C’est la leçon que donne Chris Marker dans Lettre de Sibérie en 1958 quand il s’amuse à monter trois fois les mêmes images, assorties chaque fois d’un commentaire différent. Paradoxalement, le détournement du documentaire le ramène à sa nature véritable : « Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image », selon le mot célèbre de Godard.
C’est cette nature analogique du cinéma qui l’autorise, plus encore que les autres arts, à faire du réemploi une pratique littérale. Là commence le détournement comme genre à part entière. En 1936, Joseph Cornell, artiste américain inspiré par les surréalistes et maître dans l’art de l’assemblage d’objets trouvés, met la main sur la bobine d’une série B hollywoodienne, East of Borneo (1931), et n'en conserve que les plans de l’actrice principale, mêlés aux plans documentaires d’une éclipse. Le résultat, Rose Hobart, portrait onirique et petit précis de fascination, est considéré comme un des premiers exemples d’une pratique, le found footage (littéralement : métrage trouvé), qui devait constituer un pan majeur de l’histoire du cinéma expérimental. Le geste de Cornell, promis à une riche descendance (citons Bruce Conner, Peter Tscherkassky, Martin Arnold ou, plus proche de nous, Nicolas Provost), n’est lui-même pas orphelin : la logique de détournement des ready-made de Duchamp n’est pas loin. Et là encore, cet exercice d’appropriation littérale des images (celles de l’industrie du cinéma, des bandes d’actualité, des films amateurs) interroge directement notre condition de spectateur. Faire un film à partir d’autres films, c’est peut-être moins trahir les films originaux qu’une manière d’en intensifier les propriétés (en soulignant la nature hypnotique et fétichiste du spectacle cinématographique), d’en déconstruire les principes, voire d’en révéler l’inconscient — comme s’il s’agissait de mettre films et spectateurs sur le divan.
En 1956, Guy Debord et Gil J. Wolman publient un Mode d’emploi du détournement qui a valeur de manifeste. Dans le prolongement des premiers films lettristes (Traité de bave et d’éternité d’Isidore Isou et Le film a déjà commencé de Maurice Lemaître), le mouvement situationniste fera du réemploi d’images le moyen d’une radicale déconstruction critique du spectacle : « Il va de soi, annoncent-ils, que l'on peut non seulement corriger une œuvre ou intégrer divers fragments d'œuvres périmées dans une nouvelle, mais encore changer le sens de ces fragments et truquer de toutes les manières que l'on jugera bonnes ce que les imbéciles s'obstinent à nommer des citations. » Dans La dialectique peut-elle casser des briques ? (1972), René Viénet détourne un film de kung-fu en remplaçant les répliques originales par un dialogue burlesque inspiré par la lutte des classes.
Six ans plus tôt, Woody Allen modifiait d’une manière identique le doublage d’une série B japonaise pour un résultat, Lily la tigresse, purement potache. Et c’est un même procédé qui inspirera en France, au début des années 1990, La Classe américaine de Michel Hazanavicius, piratant quantité d’extraits de films américains dans le cadre d’un projet télévisuel nommé, à juste titre, Le Grand Détournement. En vérité, le détournement d’images est devenu aujourd’hui une pratique aussi courante que populaire, épousant une logique de réappropriation qui, favorisée par la démocratisation des outils de montage et de diffusion, est devenue, sur le terrain du cinéma comme sur celui de la musique, une forme majeure de la création. Ainsi voit-on fleurir aux quatre coins d'internet une foule d’œuvres aussi minuscules que redoublant d’ingéniosité, réunies désormais sous le terme mashup (littéralement : mélange). Assemblages frankensteiniens de classiques du cinéma, remontages de bandes-annonces (Shining transformé en comédie familiale), analyse visuelle du style de grands cinéastes : autant d’inventions venues brasser la mémoire cinéphile en rappelant combien, par nature, l’œil du spectateur est toujours le lieu d’un détournement.
Auteur : Jérôme Momcilovic, critique de cinéma et essayiste. Supervision : Jean-François Buiré. Ciclic, janvier 2017.