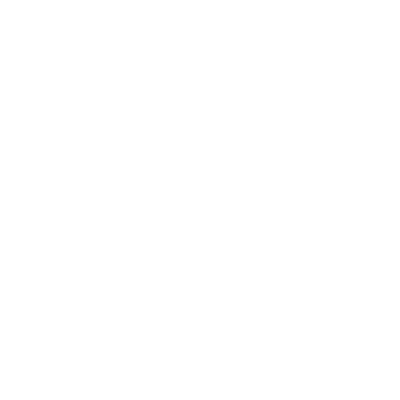La VR à l’épreuve du cinéma

Quelques allers-retours entre cinéma et VR (Virtual Reality) pour tenter d'approcher cette technique qui, loin du succès immédiat de l'invention des frères Lumière en son temps, peine à s'installer dans nos quotidiens.

Couverture du Time d'août 2015 consacrée à Palmer Luckey, l'inventeur du casque de réalité virtuelle Oculus Rift.
Régulièrement, des technologies nouvelles bousculent le cinéma. Dernière en date, la VR (Virtual Reality), qui a (surtout) envahi l'espace médiatique, s'affiche en marge de plusieurs festivals de cinéma et dans quelques salles parisiennes. Les occasions d'expérimenter ces casques et leurs contenus, dans la foulée d'une séance de film « traditionnel », imposent la comparaison avec le cinéma et permettent, avec l'appui de l'un, de penser l’autre.
Une expérience solitaire
« Testez la VR ! », « Laissez-vous submerger par l'expérience VR ! », interpellent les festivals du court métrage de Clermont-Ferrand et de Belfort, en marge de leur programmation cinématographique. Si l'achat de casques n'a pas été un raz-de-marée, ces séances spéciales affichent complet, signe que la rumeur de la course technologique d'Oculus (Facebook), HTC Vive et Sony (PSVR) est bien parvenue aux oreilles du public. Tout un chacun a envie de tester cette « nouvelle » technologie, lancée il y a sept ans.
Comme au cinéma, les expériences de VR ont souvent lieu dans une salle obscure. En fait, nulle nécessité à cela dans le cas de la VR, à moins que ce ne soit pour s'isoler du regard amusé des personnes qui pourraient vous observer une fois équipé d'un gros casque qui couvre en partie le visage. Entrer dans une salle de démo, c'est d'abord être amusé par le spectacle des porteurs de casques brassant l'air ou tournant la tête en tous sens. Et c'est bien la solitude de l'expérience qui saute aux yeux : l'individualisme criant du dispositif par rapport au spectacle collectif du film en salle, où les émotions du public se synchronisent durant un temps partagé.
Un spectateur augmenté
Selon les « contenus », on peut avoir à se munir d'un casque audio, de gants, d'un sac à dos à vibrations... Tout le nécessaire pour vivre au premier degré les sensations du réel et gommer la distance de la représentation.

Une image 2D extraite de Treehugger : Wawon (Marshmallow Laser Feast, 2017).
Afin de faire l'expérience de Treehugger : Wawona (Marshmallow Laser Feast, 2017), récompensé au festival du film indépendant de Tribeca, il faut d'abord se faire équiper d'un matériel si élaboré qu'il met la promesse d'oubli du dispositif en péril. Debout dans la salle, le spectateur se tient ensuite à un tronc d'arbre en mousse artificielle qui enrichit certes l'expérience tactile, mais donne surtout un repère physique dans l'espace pour ne pas chuter.
Le spectacle n'en est pas moins plaisant. En sept minutes, ce film d'animation fait découvrir le cheminement d'une particule d'eau, des racines à la cime d'un séquoia géant. Le ballet des lignes colorées en images de synthèse, qui matérialisent les trajectoires de l'eau, est fascinant. Paradoxalement pour une technologie qui revendique l'interaction avec le « spectacteur », l'expérience est peu narrative mais très contemplative.

Une personne équipée pour expérimenter Treehugger : Wawona.
L'immersion totale : un fantasme ancien pour une jeune technologie
De nombreuses sociétés travaillent à étoffer l'attirail de la VR (gants tactiles, son binaural, etc.) dans le but d'immerger toujours plus les spectateurs dans les mondes offerts par les contenus en réalité virtuelle.
En 2018, le film Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg, a mis en scène ce fantasme technologique. Adaptée d'un roman à succès d'Ernest Cline, l'histoire se déroule en 2045. Dans un monde devenu un immense bidonville grisâtre et irrespirable, les hommes s'échappent dans des paradis virtuels via un système qui s'apparente à ce que pourrait être une VR « réalisée ». Pour passer dans le monde virtuel et coloré de « l'Oasis », il n'y a qu'à revêtir une techno-tenue : dès lors, la frontière entre le réel et la fiction est abolie. Les intrigues qui se nouent d'un côté se poursuivent de l'autre — de nombreux raccords de mouvement insistent sur cette idée. La « suspension volontaire de la crédulité » n'a plus lieu d'être : grâce à une technologie parfaite, la représentation est abolie.

Ready Player One (2015) de Steven Spielberg.
Plusieurs films antérieurs ont placé cette thématique de l'échappée virtuelle au moyen d'une machine au cœur de leur scénario, d'eXistenZ de David Cronenberg à Matrix des sœurs Wachowski, tous deux sortis en 1999, en passant quatre ans plus tôt par Strange days de Kathryn Bigelow. Si des films ont mis en scène ce fantasme à plusieurs reprises, c'est parce qu'il est au centre des préoccupations des cinéastes narratifs : comment embarquer le spectateur dans mon histoire, le faire vivre avec mon personnage ? Les cinéastes savent qu’il est naïf de croire qu'une technologie pourrait à elle seule, de façon purement mécanique, produire une immersion totale du spectateur. Cela relève d'une alchimie complexe, née de tout un choix de cadrages, de durées de plans, de champs et de contrechamps : un travail de mise en scène, au cœur de l'écriture cinématographique.
Spectateur plus libre ou spectateur abandonné ?
C'est ce que met en scène Alfred Hitchcock dans son film Fenêtre sur cour (Rear Window, 1954). La mise en abyme du processus d'identification du spectateur qui se projette sur l'écran de cinéma (Jeffrey face aux histoires de ses voisins, visibles et audibles à travers les fenêtres de leurs appartements, de l'autre côté de la cour) se double de notre implication avec le protagoniste, par la perception duquel passe celle du spectateur : grâce au découpage en champ-contrechamp qui alterne Jeffrey et ses vis-à-vis, ce personnage relaie notre regard dans le monde de l'histoire racontée par le film.

Fenêtre sur cour (Rear Window, 1954) d'Alfred Hitchcock.
On touche ici à une différence fondamentale entre VR et cinéma, celle du choix et des partis pris. Dès qu'on s'aventure dans la théorie comme dans la pratique du cinéma, une des premières notions qui s'imposent est celle du cadrage. Cette opération, qui consiste à poser les limites d'un cadre sur le monde, suppose un acte fort. Cadrer c'est exclure, accepter de ne pas tout montrer et, dans le même temps, produire du hors-champ. Non seulement c'est à travers ces choix que s'exprime le regard du réalisateur, mais surtout ce sont eux qui guident le spectateur et lui permettent de s'immerger émotionnellement.
Or les casques de VR « vendent » le contraire : une fois chaussées, les lunettes offrent un univers total et continu, une plongée dans l'image. Plus personne ne dirige votre regard, on est « libre » de regarder où l'on veut, au centre du monde. Si l'on ne peut plus détourner le regard des images, on peut désormais bouger la tête de tous côtés. Nager au milieu des requins, voler au-dessus de Paris, explorer la jungle équatoriale, tels sont les arguments avancés par une large part des contenus en VR.
Mais avec le poids du casque sur le nez, parfois humide de la transpiration de l'utilisateur précédent, cette « liberté » risque de rendre les immersions à 360 degrés un peu longuettes. Au-delà des questions de coût de production, cela peut expliquer que la durée des contenus en VR soit relativement courte, entre trois et vingt minutes.
Voyeurisme exploratoire avec un scénario pour guide
Réalisé en 2017, Miyubi surprend d'abord par sa durée, plus longue que la moyenne des productions en VR : quarante minutes, puis par son genre : la comédie. Réalisé par le Canadien Félix Lajeunesse, il fait un usage très stimulant de la technologie à 360 degrés, spécifique de la VR.
Le film raconte l'histoire d'un petit robot offert à un garçonnet au sein d'une famille américaine des années 1980. C’est à travers les yeux de Miyubi, le petit robot japonais, que le spectateur découvre l'univers de cette maison de banlieue bourgeoise. De La Dame du lac de Robert Montgomery, en 1947, à La Femme défendue de Philippe Harrel, en 1997, plusieurs films s'étaient déjà essayés à proposer un point de vue subjectif constant. Mais le projet d'une identification totale entre personnage et spectateur y était mis en échec car on ne pouvait pas voir le protagoniste. Faute d'accéder aux expressions de son visage et, partant, à son humanité, on ne pouvait percevoir et ressentir le monde dans lequel on était censé plonger.

Miyubi (2017) de Félix Lajeunesse.
Dans Miyubi, l'enjeu du point de vue subjectif total n'est plus l'immersion ou l'identification. Ce n'est pas l'empathie avec le robot qui est recherchée, mais plutôt une forme de suspense lié à la gestion du savoir dont on est dépositaire en tant que témoin silencieux. En effet, les membres de la famille présentée dans le film s'approprient un à un ce robot rigolo et interactif (il répète certains mots, calcule, clignote à la demande, etc.) dans leurs espaces respectifs (des chambres à la salle de classe où le garçonnet fait une démonstration). Le scénario déploie les personnages et dévoile leurs intentions, notamment celles du grand-père en fauteuil, hanté depuis 1945 par la bataille d'Iwo Jima, et qui rêve de se faire la malle. Tout se déroule sans que nous puissions intervenir sur le cours des choses. Grâce à la VR, le spectateur explore visuellement les espaces au sein desquels son regard se pose. Rideaux fleuris assortis au canapé, caméscope, lecteur VHS, déguisement de princesse et dînette en plastique de la petite sœur, jeux, figurines, aquarium et cassette de new wave dans la chambre de l'adolescent aux cheveux gaufrés… Le travail minutieux de décoration replonge à l'époque des « golden eighties », âge d'or de la consommation débridée. Sous ses airs attendris de nostalgie vintage, le solide scénario déroule insensiblement un regard critique sur cette période, sur son aveuglement naïf face à la technologie et sur son égoïsme.
Le travail d’écriture porte principalement sur la caractérisation des personnages, ainsi que sur une construction narrative discrète mais efficace. Mais à ces éléments communs avec le cinéma s’ajoute l'effet d'immersion de la vision à 360 degrés, que Miyubi utilise pour permettre au spectateur de s’adonner à un plaisir exploratoire à travers les objets et les détails d’un décor savamment composé. Ce faisant, le film confirme qu'une technologie, si poussée et étonnante soit-elle, reste anecdotique et superficielle tant qu'elle n'est pas investie par des expérimentateurs ou par des artistes.
Autrice : Cécile Paturel, enseignante de cinéma. Supervision : Jean-François Buiré. Ciclic, 2019.